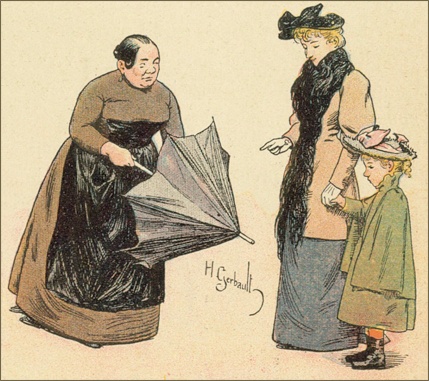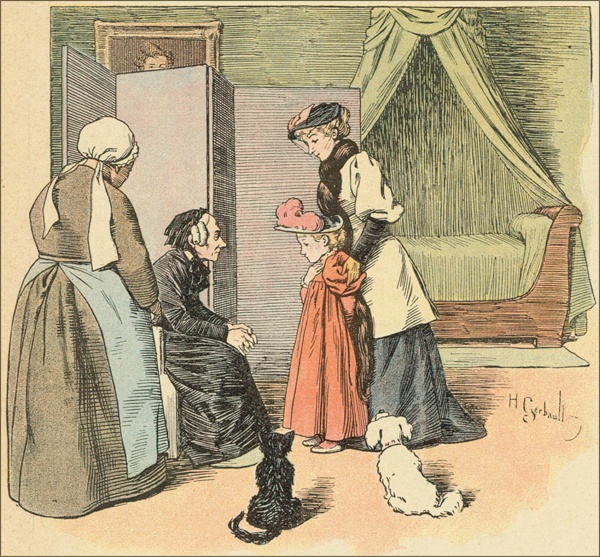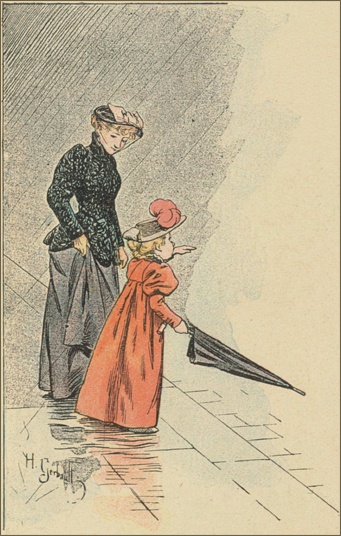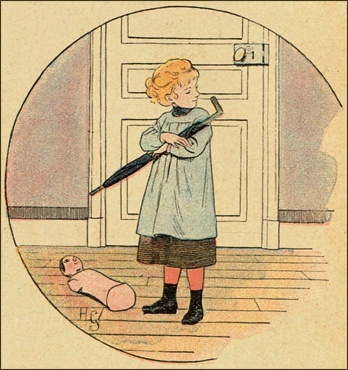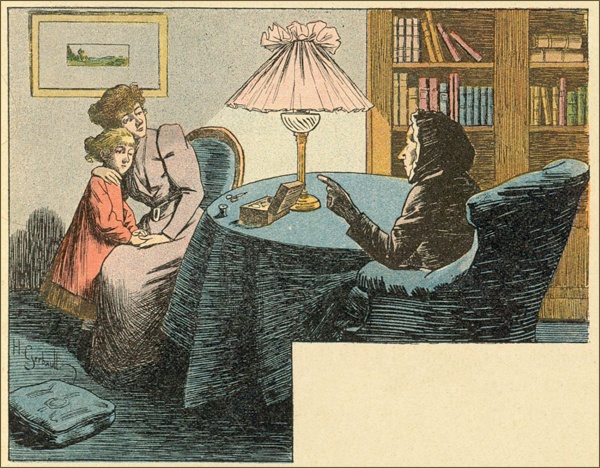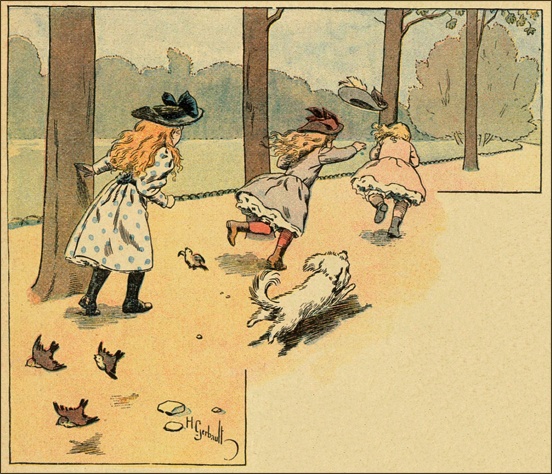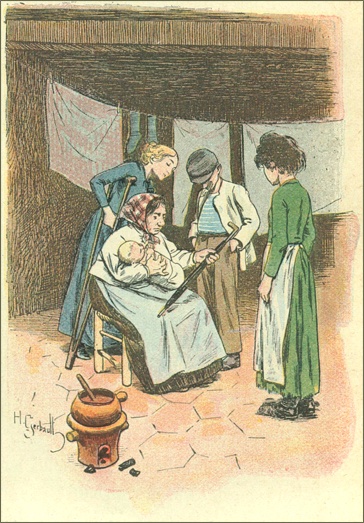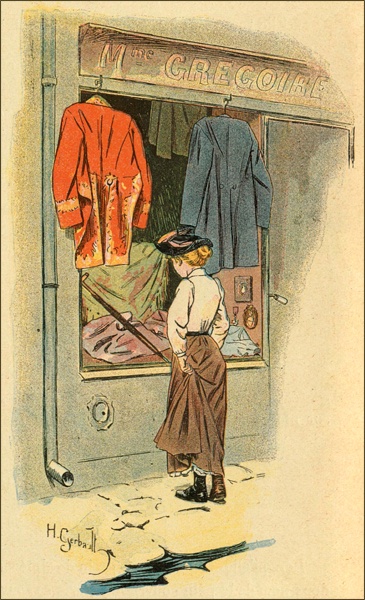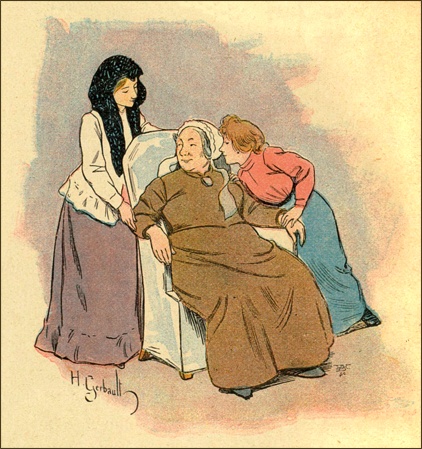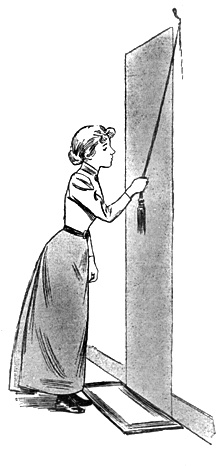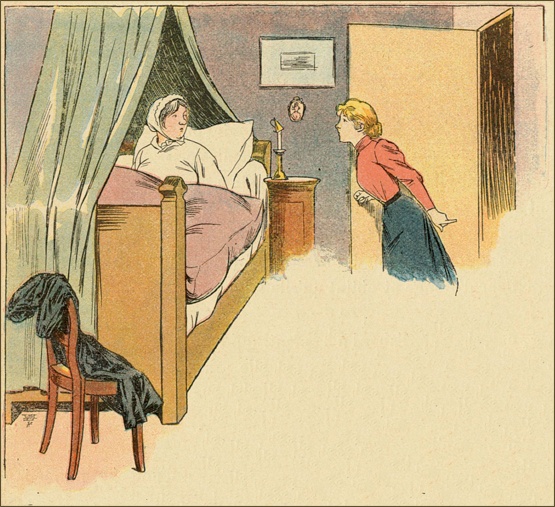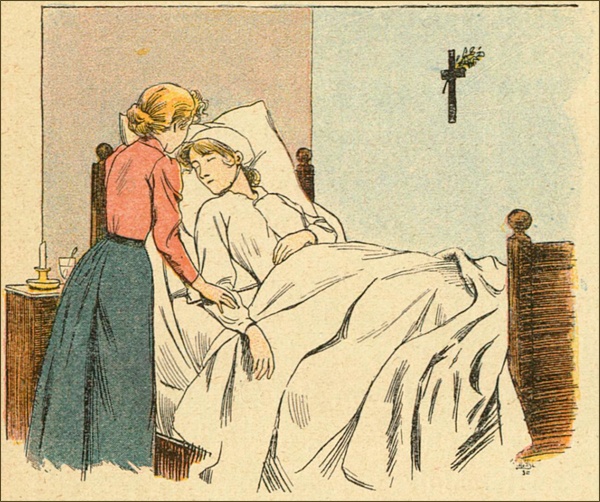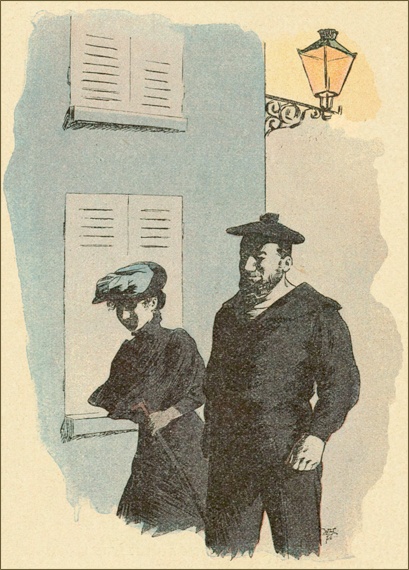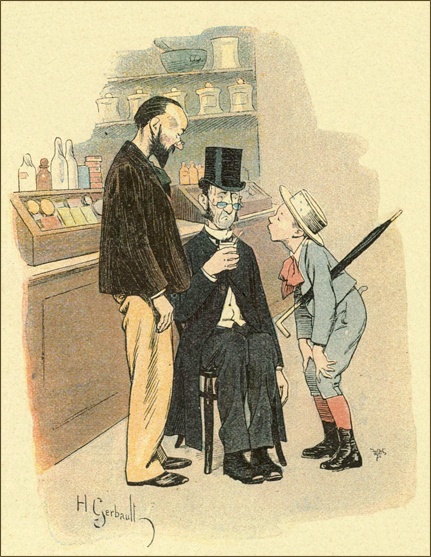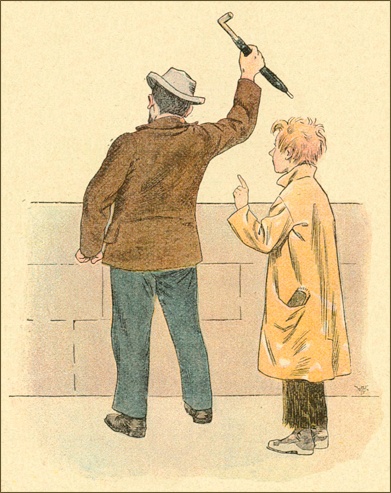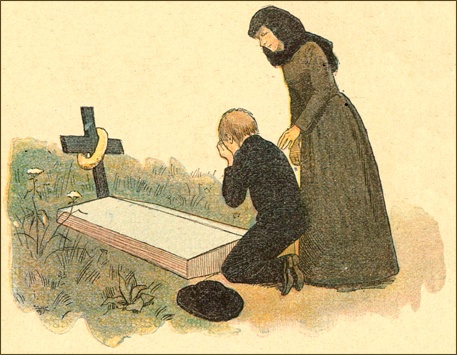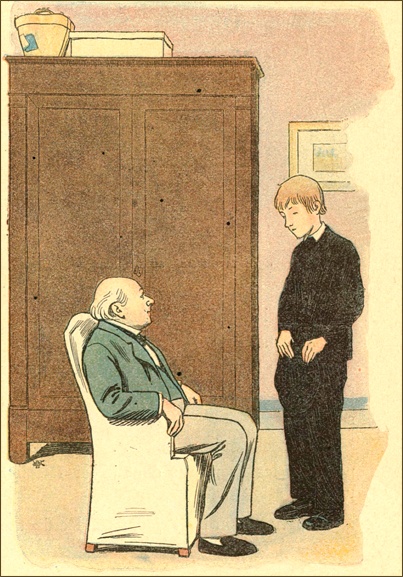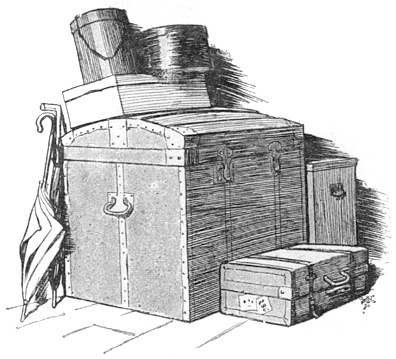*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 76540 ***
Au lecteur
Les Mémoires
d’un
Parapluie
PAR
La Comtesse de HOUDETOT
________
ALBUM CONTENANT
32 dessins en couleurs et 16 en noir
de H. GERBAULT
PARIS
LIBRAIRIE HACHETTE et Cie
79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79
1894
Droits de traduction et de reproduction réservés.
LES
MÉMOIRES D’UN PARAPLUIE
________________
1
I
MON ENFANCE ET MES DÉBUTS DANS LE MONDE
Je suis d’une naissance obscure; j’entends par là que je naquis dans
l’arrière-boutique fort sombre d’un marchand de parapluies. Ne me
demandez pas, jeunes lecteurs, des détails sur ma première enfance;
d’ailleurs seriez-vous capables d’en donner sur la vôtre?
Mes souvenirs les plus anciens remontent à une grande armoire vitrée où
je dormais dans ma gaine de cuir comme un enfant dans son maillot.
Je n’y étais pas seul: d’autres parapluies de divers genres et de
dimensions variées m’entouraient, soigneusement alignés; d’autres,
traités avec moins d’égards, formaient un faisceau compact dans un coin
rentrant du placard, où le public ne pouvait les voir. Ils étaient
vieux, et il n’y a rien de plus triste qu’un parapluie hors d’usage,
avec ses baleines qui pointent comme les os d’une carcasse décharnée,
sa soie fripée telle qu’un visage couvert de rides, sa canne usée,
son manche dédoré ou écorné; tout cet ensemble a quelque chose de
lamentable qui serre le cœur.
A défaut de beauté, ces vieux parapluies qui attendaient la réparation
dans ce coin noir, avaient beaucoup d’expérience; ayant lutté avec
persévérance contre le vent et la pluie, ils en savaient long sur la
vie, et leur conversation était des plus instructives; ce furent les
premiers éducateurs de ma jeunesse, et je leur dois de précieuses
connaissances sur le monde où j’allais bientôt faire mon entrée.
Il y avait aussi dans la même armoire, mais occupant le coin opposé
aux vieux parapluies, une petite ombrelle bleue, d’un caractère fort
aimable, avec laquelle j’étais lié d’amitié. Ah! ces affections
d’enfance, rien ne les remplace!
Les autres ombrelles habitaient des vitrines éloignées et je n’avais
aucun rapport avec elles; je les voyais passer de loin, coquettes, un
peu prétentieuses même, lorsqu’elles entraient ou sortaient du magasin,
c’était tout.
2
Il me reste maintenant à expliquer comment ma chère petite ombrelle
bleue, au lieu de prendre rang parmi ses compagnes, se trouvait égarée
parmi nous les parapluies. C’est bien simple: elle n’était jamais mise
à sa place, parce qu’elle appartenait à une jeune personne, fille
unique de la maîtresse du magasin et extraordinairement gâtée; Mlle
Antoinette Rossignol préférait laisser là son ombrelle, pour n’avoir
pas besoin d’aller la chercher dans sa chambre, située au-dessus du
magasin, quand elle devait faire une petite course pour le compte de
sa maman. On le voit, elle savait économiser ses pas; il est vrai que
c’était à peu près la seule chose qu’elle économisât, car elle était
fort dépensière et ne trouvait rien d’assez beau pour sa toilette.
Lorsque Mme Rossignol lui objectait le prix d’achat d’un objet, elle
répliquait:

[↔]
Mlle ANTOINETTE SERRAIT SON OMBRELLE.
«Bah! tu te rattraperas sur les clients; force un peu les chiffres de
vente, au lieu de me contrarier.
—C’est que les clients se défendent, soupirait cette dame, et si je
leur vends les choses plus cher qu’elles ne valent, ils sauront bien
aller ailleurs.
—Ils n’ont pas tant d’esprit que cela, répliquait la demoiselle; et
puis il y a les messieurs qui n’entendent rien à rien.»
Je crois que Mme Rossignol ne suivait que trop les mauvais conseils de
sa fille, aussi son magasin n’était-il guère achalandé et je restai
longtemps dans mon armoire vitrée sans qu’on eût besoin de moi.
Malgré les récits peu encourageants des vieux parapluies, j’avais hâte
d’en sortir et de me déployer au grand air, tant le mouvement et la
liberté ont d’attraits pour la jeunesse. En vain, ma chère ombrelle
bleue, plus sage ou plus timide, essayait de calmer mon ardeur:
«Qu’as-tu besoin de quitter ce paisible asile, me disait-elle
plaintivement, pour affronter les bourrasques et les orages dont tant
de parapluies sont victimes!
—Que veux-tu, chère amie, c’est la destinée des parapluies de braver
les averses, et mieux vaut encore remplir sa tâche au milieu des
épreuves que de végéter inutile!»
Elle soupira et je vis que je ne pourrais jamais la convaincre, tant
nos vocations étaient différentes.
3
Mais, malgré la divergence de nos opinions, nous n’en étions pas moins
bons amis. Malheureusement, l’ombrelle bleue ayant failli être vendue
par mégarde à une dame, Mlle Antoinette, qui y tenait beaucoup, se
décida à la serrer dans un endroit où elle serait à l’abri de pareilles
méprises.
La séparation fut déchirante; j’éprouvai alors le premier chagrin de ma
vie.
Un jour, comme Mme Rossignol était occupée dans son arrière-boutique,
je vis entrer dans le magasin une dame et une petite fille d’une
douzaine d’années, et, tandis que la sonnette retentissante de la porte
prévenait la marchande, les deux étrangères échangeaient le dialogue
suivant:
«Maman, disait l’enfant, je t’assure que j’aimerais beaucoup mieux une
poupée.
—Y penses-tu, ma petite Marthe! mettre à une chose aussi inutile les
vingt francs que te donne ta marraine pour tes étrennes?
—Mais, Maman, ce n’est pas inutile du tout, puisque ça m’amuse!
—Il n’est pas nécessaire d’avoir des joujoux, et surtout des joujoux
de ce prix-là, tandis que tu aurais besoin de tant de choses que je
ne puis te donner; ah! je regrette bien que ta marraine veuille te
remettre elle-même ses étrennes, et que ce soit un objet qu’il faille
montrer, sans cela je t’aurais acheté six chemises!
—Ça ne m’aurait pas fait beaucoup de plaisir; j’aime encore mieux un
parapluie.
—Tu vois donc que j’avais raison de te le conseiller! Du reste, les
parents ont toujours raison et les petites filles se trompent souvent.
—Je ne dis pas, Maman, mais, c’est égal, j’aurais bien préféré une
poupée!»
Cette protestation suprême, faiblement articulée, fut couverte par la
voix de Mme Rossignol qui demandait «ce que désirait Madame».
«Un bon parapluie pour ma fille; c’est un cadeau de Jour de l’An qu’on
lui fait, mais elle doit le choisir elle-même.
—Alors, c’est un parapluie d’enfant?
—Pardon, interrompit la cliente, je veux un parapluie sérieux, un
parapluie de grande personne, qui puisse aussi bien me servir à
l’occasion.
—Un parapluie de famille?» modula assez dédaigneusement la marchande.
4
Mais l’étrangère, tout à l’intérêt de son acquisition, ne saisit
pas l’impertinence, qui cependant fit rire toutes les ombrelles et
chuchoter les cannes entre elles dans leur râtelier. Elle poursuivit
imperturbablement:
«Je veux quelque chose de solide.
—Alors voilà votre affaire!»
Et Mme Rossignol saisit, tout à côté de moi, un gros parapluie fort
lourdement monté, démodé quoique neuf, et qui était le doyen de notre
vitrine.
«Ah! qu’il est laid! s’écria naïvement l’enfant.
—Cette soie marron ne me plaît pas, ajouta la mère; et puis ce manche
n’est pas nouveau, c’est un parapluie que vous devez avoir depuis
longtemps en magasin?
—Dame! murmura la marchande assez confuse, ce n’est pas la dernière
nouveauté, mais aussi je vous aurais fait un rabais.»
Voyant que sa cliente savait parfaitement acheter, elle n’essaya pas
davantage d’égarer son choix. Aussi, marchant tout droit vers moi:
«Voici ce que j’ai de mieux en fait de parapluie, dit-elle. Voyez
plutôt: le manche est charmant, la monture bien finie et la soie
croisée parfaitement souple; or, vous ne l’ignorez pas, Madame, ces
soies souples ne se coupent pas, comme les autres.»
Tout ce qui précède était fort exact et la dame ne put qu’acquiescer,
tout en m’examinant avec le plus grand soin. Mon émotion était
extrême, bien qu’il n’en parût rien, car les parapluies n’ont aucun
moyen d’exprimer leurs sentiments. Comme l’examen se prolongeait, Mme
Rossignol dit encore:
«Si ce vert foncé, vert myrte, comme nous l’appelons, ne vous plaisait
pas, nous avons encore la couleur carmélite, qui est très bien portée,
quoique moins nouvelle.»
Mais la petite demoiselle déclara qu’elle aimait mieux le vert et
qu’elle me trouvait très joli. Le compliment me fit plaisir; c’était le
premier que je recevais.
Restait à débattre la grosse question du prix.
«Vingt-quatre francs», dit Mme Rossignol.
La cliente se récria: C’était un cadeau de vingt francs qu’on faisait
à sa fille, et elle entendait n’y rien ajouter de sa poche; d’ailleurs
le parapluie ne valait pas davantage; on les vendait même à bien
meilleur marché dans les grands magasins de Paris (j’habitais alors
Bordeaux), et il n’était pas difficile de faire venir quelque chose du
Louvre ou du Bon Marché.
En entendant ces noms exécrés de tous les petits marchands, Mme
Rossignol commença à faiblir: «Elle y perdrait, mais pour contenter une
nouvelle cliente, elle consentait à rabattre deux francs; Madame serait
raisonnable et ferait de son côté une petite concession.»
Mais elle avait affaire à forte partie, et quand elle vit la mère de la
petite Marthe battre en retraite vers la porte sans concéder un sou et
prête à en passer le seuil, elle me céda pour vingt francs.
5
«Allons, Madame, prenez-le donc à votre prix; j’y mets du mien, c’est
dans l’espoir que vous recommanderez la maison.»
Elle passa par-dessus ma gaine un étui de papier gris; j’eus à peine
le temps de murmurer un dernier adieu à mes camarades les parapluies
neufs, à nos vétérans les parapluies en réparation, de donner un
souvenir à ma chère petite ombrelle bleue.... J’entendis un instant
des voix, perceptibles pour moi seul, qui disaient: «Adieu! Au revoir!
Bonne chance!» C’en était fait! je me trouvais dehors, au grand air,
lancé dans le monde, le vaste monde, emporté dans les bras d’une petite
fille qui ne savait trop comment me tenir, car j’étais presque aussi
grand qu’elle.

[↔]
LA PETITE FILLE M’EMPORTAIT.
Faut-il décrire mes impressions quand je me sentis à l’air libre? La
première, la plus distincte, fut que j’entrais dans mon élément; en
effet un parapluie a été créé, je veux dire fabriqué, pour un service
tout extérieur, et la vie casanière du bibelot lui est absolument
antipathique. J’étais charmé de me trouver dans la rue, de me mêler
au mouvement, et j’appelais de tous mes vœux une petite averse qui me
permît de m’épanouir dans tout l’éclat de ma beauté et de ma jeunesse.
En cela, j’avais tort, car la pluie serait venue inutilement pour moi,
l’heure où je devais entrer dans ma carrière n’étant pas encore tout à
fait sonnée. Quand bien même, en effet, il serait tombé des torrents,
la jeune Marthe n’eût pas osé se servir de sa nouvelle acquisition, qui
devait au préalable passer par les mains de sa marraine; elle était
censée ignorer mon existence, destinée à se révéler sous la forme d’une
aimable surprise.
Je fus donc porté avec quelque mystère chez Mme veuve Trofé, et
placé dans un grand placard, en attendant le jour de la délivrance,
c’est-à-dire celui du 1er janvier.
Je m’ennuyai beaucoup chez cette vieille dame qui vivait entre son chat
Mousquetaire, son chien Bichon et sa bonne Pétronille.
J’appelais de tous mes vœux l’heure des compliments et des étrennes qui
devait mettre un terme à ma captivité, laquelle me semblait d’autant
plus pénible que j’avais entrevu la liberté.
Enfin le 1er janvier arriva, et avec lui la petite Marthe, rouge et
intimidée, toute raide dans une toilette neuve. Soufflée par sa mère
qui l’encourageait à voix basse, elle récita, presque sans reprendre
haleine, un compliment qui avait bien trois pages; on eût dit une
lettre de Jour de l’An apprise par cœur; mais, sans doute, c’était
fort beau, car tout le monde parut ravi et en particulier la mère de
la jeune personne. Pétronille, qui écoutait, familièrement appuyée sur
le dossier du fauteuil de sa maîtresse, vint alors me tirer du fond
de mon armoire et m’apporta triomphalement à Mme Trofé, laquelle me
remit à Marthe d’un air solennel. Je fus reçu avec les marques 6
d’un vif plaisir, Marthe ayant enfin compris, grâce, sans doute, aux
exhortations de sa mère, qu’une poupée ne convenait guère à une grande
fille de douze ans, et qu’il valait beaucoup mieux pour elle recevoir
un «cadeau utile».
Me voilà donc chez ces Duvignot! Il convient que je donne d’abord
quelques détails sur l’intérieur où je fis mes débuts.
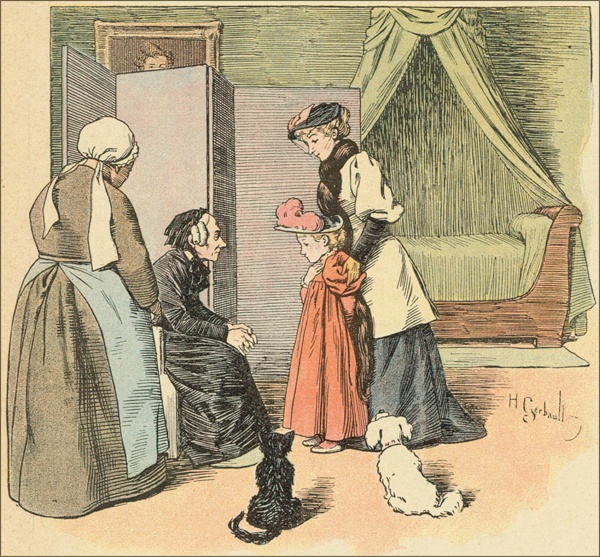
[↔]
MARTHE RÉCITA SON COMPLIMENT.
La famille Duvignot se composait de quatre personnes: le père, modeste
employé dans une administration du Gouvernement; la mère, qui se
consacrait aux soins du ménage; un fils, appelé Adrien, alors âgé de
dix-sept ans; et enfin la petite Marthe, qui allait en pension dans le
voisinage. A cette dernière je m’attachai facilement, quoiqu’elle eût
ses défauts. C’était une bonne petite fille, qui aimait ses parents et
contentait ses maîtres. Mais son frère Adrien était un triste sujet:
commis dans une boutique de mercerie, il était déjà prétentieux et
plein de vanité. Il dépensait tous ses maigres appointements à sa
toilette et tenta immédiatement de s’emparer de moi; heureusement que
sa jeune sœur, ne l’entendant pas ainsi, me défendit contre lui avec la
plus grande énergie.
Il y avait déjà un mois que j’étais chez les Duvignot lorsque je reçus
ma première goutte de pluie.
C’était un dimanche, et la mère et l’enfant sortaient de l’église quand
l’averse commença:
«Maman, dit la petite fille, si je mettais mon beau parapluie sous mon
manteau? J’ai si peur de l’abîmer!»
7
Je frémis de honte; allait-elle me déshonorer et se couvrir de
ridicule? Vous ne l’ignorez pas, mes chers lecteurs, on met un manteau
à l’abri sous un parapluie, mais jamais on ne place un parapluie sous
un manteau.
Heureusement que Mme Duvignot, en femme de bon sens, répondit:
«Au contraire, ma petite, il faut ouvrir ton parapluie qui nous
empêchera toutes les deux d’être mouillées, et une ondée ne lui fera
aucun mal, je t’en réponds.»
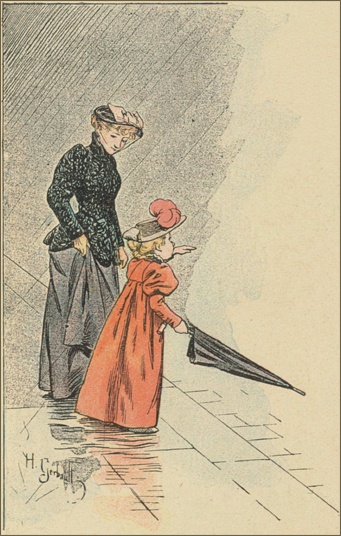
[↔]
«IL FAUT OUVRIR TON PARAPLUIE.»
L’enfant obéit et je m’épanouis sous cette bienfaisante giboulée.
Avec quel plaisir je sentais tomber sur ma soie bien tendue ces gouttes
d’eau qui semblaient de petits coups de doigts légers sur un tambour
de basque! un bruit gai et sonore, quelque chose d’entraînant, et la
preuve, c’est que ces dames pressaient instinctivement le pas. J’étais
à la fois ému, enivré, un peu troublé.... Je m’imagine que le jeune et
vaillant conscrit qui va pour la première fois au feu doit éprouver des
impressions de ce genre; seulement, pour nous autres, c’est l’eau qui
est notre élément de bataille, celui dans lequel nous devons vivre et
mourir.
Telle fut mon inauguration officielle.
A quelques jours de là, comme le temps était fort menaçant, M. Duvignot
dit à sa fille:
«Marthe, veux-tu me prêter ton parapluie pour aller au bureau? le mien
est à raccommoder.»
En effet, mon pauvre camarade, depuis quelque temps déjà dangereusement
malade, avait été envoyé chez son médecin, où il devait rester quelques
jours en traitement.
Naturellement ma petite maîtresse acquiesça avec empressement à la
demande de son père, et courut me chercher sous ma serge verte. Mais,
en dépit des gros nuages noirs qui encombraient le ciel, le temps se
maintint jusque vers quatre heures, c’est-à-dire que la pluie commença
à tomber juste à la sortie des bureaux.
Comme M. Duvignot venait de m’ouvrir, il aperçut son chef, M. Reis, qui
s’arrêtait indécis sur le seuil de la porte cochère en marmottant entre
ses dents:
«Quelle distraction d’avoir oublié mon parapluie! Aussi ma femme aurait
dû m’y faire penser; et justement j’ai mon pardessus neuf!»
M. Duvignot ne fit qu’un bond jusqu’à son supérieur hiérarchique.
«Monsieur Reis, faites-moi l’honneur d’accepter mon parapluie, pour
aller jusque chez vous.
8
—Mais non, mon cher Duvignot, je me reprocherais de vous faire
mouiller.»
En somme, il se défendait assez mollement; l’employé insista:
«N’y songez pas un instant, je demeure tout près d’ici, et encore j’ai
un bout de chemin à couvert par les galeries; prenez mon parapluie ou
je croirai que vous ne le trouvez pas digne de vous.
—Mais il est fort joli, au contraire (mon maître et moi, nous fûmes,
très sensibles au compliment), seulement je ne veux pas vous en priver.
—Vous me désobligeriez en le refusant.
—S’il en est ainsi, je l’accepte.»
Et je passai dans les mains de M. Reis, qui décidément se laissait
faire une douce violence.
Je crois que mon maître, qui demandait de l’avancement, était enchanté
de cette occasion de rendre un petit service à son chef direct; mais,
comme il arrive souvent, ce dernier attacha beaucoup moins d’importance
à ce léger incident que ledit subordonné, si bien qu’en arrivant
chez lui, il me déposa dans un porte-parapluie qui se trouvait dans
son antichambre, et ne songea plus à moi. Il ne pensa pas même à me
renvoyer à mon légitime propriétaire, à qui je devais fort manquer,
mais qui ne me manquait pas du tout, ce changement de résidence faisant
une agréable diversion dans ma vie.
Le porte-parapluie dans lequel m’avait déposé M. Reis contenait une
charmante réunion au milieu de laquelle je fus heureux de me trouver.
Nous étions là deux cannes, un gros parapluie cossu, mais peu élégant,
et moi: un vrai salon et, qui plus est, un salon distingué. Je vous
assure que la société dont je faisais alors partie était très agréable.
Je commençais à me féliciter de l’aventure à la suite de laquelle
j’étais entré chez M. Reis, et je faisais des vœux pour ne plus
retourner chez les Duvignot.
Aussi est-ce presque avec regret que j’entendis tout à coup Mme Reis
s’écrier en m’apercevant:
«Ah! vois donc, Jules; à quoi as-tu songé? Depuis deux jours tu gardes
ici le parapluie de M. Duvignot, et il n’a pas cessé de pleuvoir!
—Ma foi! ce parapluie m’est sorti de la tête; tu aurais dû m’en faire
souvenir.
—J’ai bien d’autres choses à penser!
—Et moi donc! crois-tu qu’avec toutes mes préoccupations j’aie le
temps de m’occuper du parapluie de M. Duvignot!
—Tu ne pourras pas te dispenser, après avoir fait mouiller jusqu’aux
os ce pauvre garçon, d’appuyer sa demande d’avancement.
—Il a peut-être d’autres parapluies, répondit le mari.
—On n’a jamais assez de parapluies dans une famille», fit observer
doctoralement 9 Mme Reis, et cette remarque me parut à la fois
flatteuse et pleine de profondeur.
En conclusion, on me rapporta chez les Duvignot, et Marthe me fit un
accueil charmant, sans doute parce qu’elle avait craint de me perdre;
j’en fus touché et je me serais retrouvé avec plaisir dans ses mains,
n’eût été ce mauvais sujet d’Adrien dont la présence me gâtait ce
modeste mais honnête intérieur.
II
JE SUIS MIS EN LOTERIE
J’avais bien raison de craindre ce vilain garçon. Dans les
commencements, Marthe, qui se méfiait aussi de lui, faisait bonne garde
autour de moi; mais comme il semblait avoir absolument renoncé à se
servir d’un parapluie qui ne lui appartenait pas, avec la légèreté
habituelle à l’enfance elle se départit peu à peu de sa surveillance,
si bien qu’un soir, tandis qu’elle apprenait ses leçons auprès du
feu, dans l’étroite salle à manger où la famille faisait la veillée,
Adrien se faufila sans bruit dans la chambrette de sa sœur et vint en
tâtonnant me saisir sous mon rideau.

[↔]
JE PRIS PLACE DANS UN PORTE-PARAPLUIE.
J’aurais voulu pouvoir lancer un retentissant «Au voleur!», mais les
parapluies ne savent pas crier, ils peuvent tout au plus pleurer, et
encore faut-il que la pluie les y aide.
Il pleuvait ce soir-là, mais le but de notre course se trouvait peu
éloigné; c’était un petit estaminet de médiocre apparence où Adrien
allait rejoindre un autre garnement de son âge qui avait comme lui
la passion du jeu et avec lequel il faisait d’interminables parties
d’écarté.
Ce soir-là, comme il arrivait du reste souvent, la chance ne fut pas
favorable à mon maître d’occasion, car je le vis tirer successivement
toutes les petites pièces d’argent que contenait son porte-monnaie,
et il s’obstinait toujours avec cet entêtement rageur qui distingue
le joueur. L’adversaire, calme et souriant, empochait la monnaie sans
sourciller, mais au moment précis où il s’aperçut qu’il n’y en avait
plus, il déclara la séance levée. Ce n’était pas l’affaire d’Adrien qui
voulait se rattraper, et il proposa de jouer sur parole; le gage ayant
paru insuffisant, une idée diabolique germa subitement dans son cerveau
surexcité:
«Tiens! s’écria-t-il, je vais te jouer mon parapluie!»
Il osa dire «mon», employer cet adjectif possessif auquel il n’avait
aucune espèce de droit, mais l’anxiété ne permettait pas à mon
indignation de suivre son cours.
10
Augustin (c’était le nom de l’ami), après m’avoir examiné à la dérobée,
accepta cette monstrueuse proposition.
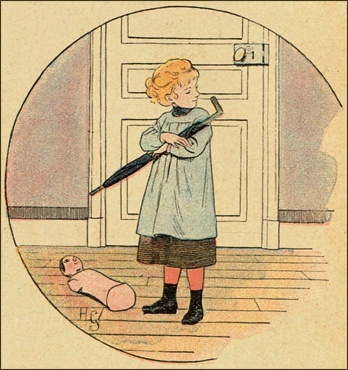
[↔]
MARTHE ME FIT UN ACCUEIL CHARMANT.
On me jouait en cinq points!
Ces cartes qu’on retournait allaient décider de mon sort. Ce fut un
moment bien douloureux; les chances se balançaient, la partie restait
indécise entre les deux adversaires, enfin Adrien, plus heureux certes!
qu’il ne le méritait, triompha et put rentrer chez lui avec quelque
argent et le parapluie de sa sœur; mais, comme on le verra par la
suite, ce succès fut un fâcheux encouragement pour lui dans une voie
fatale qui devait le mener à sa perte.
Bientôt, afin de satisfaire sa malheureuse passion des cartes, ce
garnement se livra à des détournements de marchandises dans le magasin
où il était commis et où, sans doute, on se méfiait déjà de lui, car
son vol fut promptement découvert. On imagine le désespoir des parents,
la confusion du coupable.... Pour éviter un éclat funeste, M. Duvignot
s’engagea à payer les deux cents francs manquants; seulement, cette
somme ne laissant pas d’être considérable pour lui, il demanda quelques
jours de crédit, qui lui furent accordés.
Trouver ces deux cents francs n’était pas chose facile: les Duvignot
vivaient péniblement, au jour le jour, et ne possédaient aucune
économie. Mme Duvignot, tremblante et désolée, se décida à tenter une
démarche auprès de Mme Trofé, la marraine de Marthe.
Elle la trouva somnolente, entre son chien et son chat qui dormaient
aussi, et réveilla en sursaut tout le monde, ce qui était un bien
fâcheux début.

[↔]
ADRIEN AVAIT LA PASSION DU JEU.
«Ah! ma chère, quelle peur vous m’avez faite! s’écria Mme Trofé; j’ai
cru que c’était un assassin!»
Lorsque l’ex-maîtresse de pension apprit de quoi il s’agissait,
elle jugea qu’un emprunteur ne valait guère mieux que l’assassin en
question, et, sans bouger de son fauteuil, mit en fuite la mère éplorée
en lui reprochant d’avoir mal élevé son enfant.
Dans la même maison que les Duvignot, mais à l’étage supérieur,
c’est-à-dire 11 dans les mansardes, vivait une vieille fille,
nommée Mlle Florentin; c’était une très honnête personne, qui allait
travailler en journée dans les maisons particulières; elle avait une
belle clientèle et elle aurait amassé une petite fortune, si deux
sœurs mariées et pourvues de nombreux enfants ne s’étaient chargées de
dévorer à mesure tout l’argent qu’elle gagnait et qu’elles se faisaient
donner.
Pour économiser le feu et la lumière, Mlle Florentin venait quelquefois
le soir passer un moment chez les Duvignot. Parfaitement au courant
du malheur qui leur était arrivé, elle ne manqua pas, le jour de la
visite à Mme Trofé, de descendre auprès de Mme Duvignot; elle la trouva
pleurant avec la petite Marthe, et on lui raconta l’insuccès de la
démarche.
«Je prévoyais qu’elle ne voudrait pas, dit Mlle Florentin. Mais ne vous
découragez pas....
—Vous croyez donc que nous pourrions nous tirer d’affaire?
—Certainement, en cherchant un moyen sans se déconcerter.
—Mais c’est que je n’en vois aucun!
—Que si! Tenez, il me vient une idée: à votre place je ferais une
loterie!»
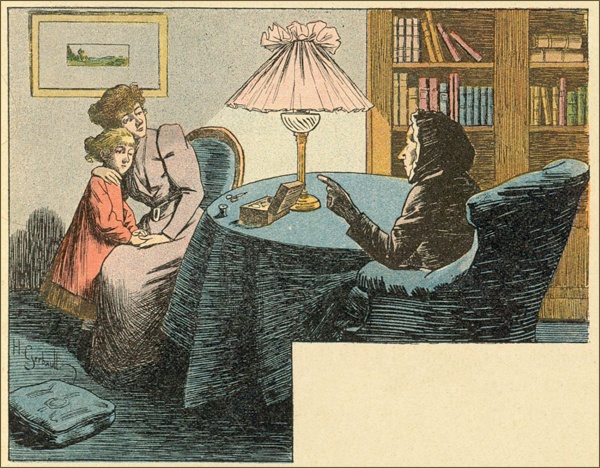
[↔]
«FABRIQUEZ CENT BILLETS, JE ME CHARGE DU RESTE.»
La mère et la fille la regardèrent avec stupeur, se demandant si elle
parlait sérieusement; mais la vieille demoiselle, souriant d’un air
paisible, ajouta:
«Dame! il faut sacrifier un objet ou bien confectionner un bel ouvrage;
pour une loterie, il faut un lot! On fait des billets pour la somme
dont on a besoin, on les place parmi ses connaissances, et le tour
est joué, sans avoir causé préjudice à personne, car on tire bien
honnêtement la loterie et on porte le lot à celui ou à celle qui l’a
gagné.
—Cette idée me paraît excellente, dit Mme Duvignot devenue subitement
toute songeuse; mais, ajouta-t-elle, sur un ton plein de tristesse,
après un petit moment de réflexion, je n’ai malheureusement pas le
temps de faire le bel ouvrage qui devrait constituer le lot, et chez
moi je ne possède pas d’objet de prix.
12
—Bah! on trouvera bien quelque chose.
—Et puis, comment placerais-je les billets, surtout en grand nombre?
J’en caserais à peine dix ou douze.
—Voyons, combien vous faut-il d’argent? N’avez-vous pas déjà une
partie de la somme qui vous est nécessaire?
—Nous avons cent francs sur les deux cents que nous devons rembourser.
—Eh bien, fabriquez cent billets; Marthe, qui a une jolie écriture,
pourra l’utiliser; vous en placerez quelques-uns et je me charge du
reste. Je vais dans des maisons riches où l’on a des égards pour moi;
je dirai qu’il s’agit d’une bonne œuvre, ce qui est vrai, puisqu’il
s’agit de rendre service à votre mari et à vous qui êtes de braves
gens.»
Mme Duvignot éclata de nouveau en sanglots.
«Ne pleurez pas, Madame Duvignot! Songeons plutôt à notre loterie, car
nous n’avons pas encore le lot.»
On chercha longtemps en vain: la pendule était bien laide; les six
petites cuillères d’argent, qui représentaient toute l’orfèvrerie de la
maison, avaient le tort d’être marquées aux initiales du ménage; une
broche cassée fut jugée absolument passée de mode. Tout à coup Marthe
s’écria:
«J’ai un parapluie tout neuf, ou, du moins, il n’a servi que deux ou
trois fois, et cela ne se voit pas!»
Je fus examiné attentivement; grâce aux soins dont j’avais été entouré,
je semblais vraiment sortir du magasin, et je fus choisi à l’unanimité
pour servir de prétexte à cette modeste loterie qui devait sauver
l’honneur d’une famille.
On eut une certaine difficulté à placer ces cent billets, d’autant plus
que le but de la bonne œuvre en question devait rester un peu obscur,
ce qui diminuait l’intérêt des âmes charitables.
Marthe, qui était fort intelligente pour son âge, parvint à en faire
prendre quelques-uns par sa maîtresse de pension et ses compagnes; la
fruitière du coin, tentée par le parapluie, risqua aussi vingt sous;
puis, la fille de la laitière, qui allait se marier et espérait ainsi
monter son ménage d’un objet utile, prit aussi un billet. Mais, comme
elle l’avait promis, ce fut encore Mlle Florentin qui en plaça la plus
grande quantité parmi ses riches clientes. Aussi, lorsque la loterie
eut lieu, j’échus en partage à la fille d’un gros négociant de la
ville, Mlle Madeleine Lecourier, qui avait fort multiplié ses chances
en prenant un grand nombre de numéros. La fruitière, qui n’en possédait
qu’un, n’en éprouva pas moins une forte indignation et se prétendit
«refaite» de ses vingt sous; la jeune laitière se plaignit également et
fort amèrement du sort: la déception des deux commères était d’autant
plus vive qu’on les avait convoquées au tirage de la loterie et
qu’elles assistaient à leur défaite.
13
L’heure du sacrifice sonnait enfin pour Marthe. Elle me remit,
le cœur un peu gros, à Mlle Florentin qui devait me porter à mon
nouveau domicile. Quant au coupable, il n’était point là. On disait
officiellement qu’on l’avait envoyé à la campagne, mais je crois que
cette campagne peu agréable pouvait bien être une maison de correction.
Mlle Madeleine Lecourier me reçut avec une indifférence souriante des
mains de Mlle Florentin; c’était une charmante petite fille, aimable
et bonne, mais quelque peu blasée sur les cadeaux, qu’ils vinssent des
personnes ou du sort. Elle dit seulement en me voyant:

[↔]
«QUELLE PEUR VOUS M’AVEZ FAITE!»
«Ah! un parapluie! ça tombe bien; justement j’ai perdu le mien!
—C’était le troisième depuis l’année dernière», fit observer
froidement Miss Mary, l’institutrice anglaise.
Madeleine avait deux frères et une petite sœur que sa maman nourrissait
encore. Mme Lecourier, fort absorbée par son bébé, qui était faible et
délicat, ne s’occupait pas beaucoup de sa fille aînée, âgée de huit
ans, dont l’éducation se trouvait ainsi presque exclusivement dirigée
par Miss Mary.
Il pleut beaucoup à Bordeaux, et Madeleine m’emmenait souvent avec
elle. Nous allions donc au cours, puis chez sa maîtresse de piano, où
elle prenait plusieurs leçons par semaine. Elle avait une amie appelée
Marguerite qu’elle allait voir fréquemment, mais si nous partions de
compagnie pour ces différentes courses, il s’en faut bien que nous
revinssions toujours ensemble; Madeleine m’oubliait régulièrement
une fois sur trois, et je compris, en constatant combien elle était
désordonnée, que je ne resterais pas longtemps dans ses mains.
Un jour vint, en effet, où elle me perdit pour de bon, et je vais
vous raconter dans quelles conditions; cela servira peut-être
d’avertissement aux petites filles sans soin.
Le jeudi, lorsque le temps le permettait, Madeleine passait une partie
de son après-midi sur la belle promenade de Bordeaux appelée les
Quinconces; elle y retrouvait son amie Marguerite et d’autres petites
filles de son âge, avec lesquelles elle jouait à toutes sortes de jeux:
aux barres, à cache-cache, aux quatre coins, et principalement à des
jeux où l’on court, sauf quand il faisait trop chaud.
Un jour que la température était lourde et orageuse, on décida d’un
commun 14 accord qu’il fallait chercher un jeu pendant lequel on
pût rester assis. Mais les bancs, fort espacés les uns des autres, ne
favorisaient aucune combinaison, et on ne savait à quoi se résoudre,
lorsque Marguerite, la plus âgée de la bande, proposa d’aller assister
à une représentation de Guignol.
«C’est une bonne idée!» s’écrièrent en chœur les petites filles.
Les gouvernantes furent consultées, et elles acquiescèrent volontiers;
pendant que ces demoiselles seraient bien tranquilles, le nez en
l’air, à regarder Guignol battre le commissaire, elles pourraient donc
continuer en paix leurs interminables conversations.
La bande joyeuse occupait à elle seule deux rangées de places;
Madeleine Lecourier était assise au premier rang, à l’extrémité d’un
banc.
Le répertoire de Guignol n’est pas très varié; il faut même avouer
que les générations se succèdent devant son petit théâtre sans
que la moindre modification se produise dans ses représentations:
c’est toujours l’éternelle concierge assise au coin de sa cheminée,
tandis que Guignol, son locataire indélicat, aidé de son complice
Polichinelle, déménage en faisant passer ses meubles par la fenêtre;
puis l’intervention du commissaire qui, battu, assommé, vient tomber
sur le bord de la scène, les deux bras pendant au dehors. Ces pièces
sont devenues classiques; malgré tout, les enfants ne s’en lassent
jamais.
Madeleine, attentive, sérieuse, intéressée, suivait d’un œil charmé
les brusques évolutions des petits personnages, riant avec éclat,
applaudissant avec entrain, mais comme je la gênais un peu dans cette
dernière démonstration, elle m’appuya contre le théâtre, et, ainsi
débarrassée de son parapluie, elle l’oublia complètement, selon son
habitude.
Tandis que ma propriétaire légitime, tout à son amusement, me
délaissait de la sorte, un œil plein d’admiration et d’envie s’ouvrait
sur moi, me contemplant avec persévérance à travers un trou produit par
quelque accroc dans la toile qui entourait le bas du théâtre. Cet œil
cependant quitta précipitamment son observatoire, quand une grosse voix
mécontente murmura:
15
«Si tu ne me passes pas la mère Michel, tu peux être sûre et certaine
d’être calottée après la représentation; v’là deux fois que tu leur z’y
fais manquer leur entrée, paresseuse!»
La grosse voix n’eut pas besoin de répéter cet avertissement, dont il
fut soigneusement tenu compte.
Mais dès que la mère Michel fut en scène, l’œil reprit sa faction
et il me sembla qu’il s’animait de plus en plus d’une expression de
convoitise. Je ne me trompais pas, car au moment le plus palpitant
de la pièce, alors que toute l’attention du jeune auditoire était
captivée par l’intérêt poignant de la situation, une petite main,
assez malpropre mais pleine de dextérité, passa par la fente du rideau
qui masquait de côté l’entrée du théâtre, s’empara de moi et m’attira
preste prestement dans l’intérieur du petit édifice.

[↔]
L’ATTENTION DES SPECTATEURS ÉTAIT CAPTIVÉE PAR L’INTÉRÊT
DU SPECTACLE.
J’étais dans les coulisses du Guignol.
Sur une table boiteuse gisaient tous ces personnages familiers (à
l’exception de ceux qui étaient en scène à ce moment) dont nous avons
déjà parlé: Guignol, le commissaire, etc.; et ils ne gagnaient pas
à être vus de près, avec leurs visages grossièrement enluminés et
leurs costumes défraîchis. Un homme en blouse les faisait manœuvrer
et parler, aidé par une fillette d’une quinzaine d’années. Le visage
pâle de cette dernière n’eût pas été laid, si une expression fausse
et méchante ne l’avait déparé; elle appelait l’homme en blouse «mon
oncle», et il la nommait Fifine.
Fifine, par un mouvement adroit, m’avait jeté dans un coin derrière
elle, et son oncle, très absorbé par la représentation, ne s’était
nullement aperçu de mon entrée subreptice.
Bientôt une grande ombre tomba sur notre réduit; c’était la toile qui
se baissait, 16 et un petit tumulte se fit autour du théâtre. Les
enfants se levaient tous ensemble pour s’en aller, car le spectacle
avait pris fin. Il me sembla entendre encore la voix de Madeleine.
Allait-elle s’apercevoir de ma disparition? Point du tout, la petite
étourdie parlait avec animation de la pièce de Guignol, et ne songeait
pas à son parapluie; les derniers échos de sa conversation se perdirent
enfin dans l’éloignement.
III
BIEN VOLÉ NE PROFITE PAS
Ce fut dans un bien pauvre intérieur que Fifine me déposa trois quarts
d’heure plus tard, car nous dûmes traverser une grande partie de la
ville et d’un faubourg populeux avant d’atteindre le but de notre
longue course.
Les Louriguet habitaient une maison noire haute de plusieurs étages, au
fond d’une sorte d’impasse.
La famille, outre ses deux membres que nous connaissons déjà, se
composait d’une mère boiteuse qui paraissait peu intelligente et
même comme abrutie par la misère et un travail excessif, et de trois
enfants, une fille et deux garçons, dont le dernier était encore
au berceau. La fille, Noémie, qu’on appelait Mimi, semblait un peu
plus jeune que sa cousine Fifine. Elle avait hérité, en l’exagérant,
de l’infirmité de sa mère, et boitait au point qu’il lui fallait
s’aider d’une béquille pour remédier au manque d’équilibre entre ses
deux jambes; aussi ne sortait-elle guère et subissait-elle une sorte
d’étiolement, suite naturelle de sa vie sédentaire dans ce triste
logis, mais ses traits amaigris portaient l’empreinte d’une douceur
angélique qui contrastait étrangement avec les figures vulgaires du
reste de la famille.
Il n’entrait sans doute guère de jolis objets dans ce sordide
intérieur, car mon apparition y fit sensation.
«D’où sort ce beau parapluie? Qu’est-ce que c’est que ce bijou-là?
Fais-le-moi donc voir, Fifine.
—Bien sûr, tu as dû le voler!» dit rudement la tante, sans manifester
d’ailleurs grande indignation, mais constatant un fait probable: elle
connaissait bien sa nièce et la savait capable d’un larcin; peut-être
même Fifine n’en était-elle pas à son coup d’essai.
17
La jeune fille hésita quelques secondes et se défendit avec un certain
embarras:
«Je ne l’ai pas pris dans les mains de quelqu’un, vous pouvez croire.
—Mais alors, de quoi qu’il en retourne?
—C’est pas ma faute si certains enfants sont des sans-soins et s’ils
perdent ce qu’ils ont sans se soucier de l’argent que ça coûte.
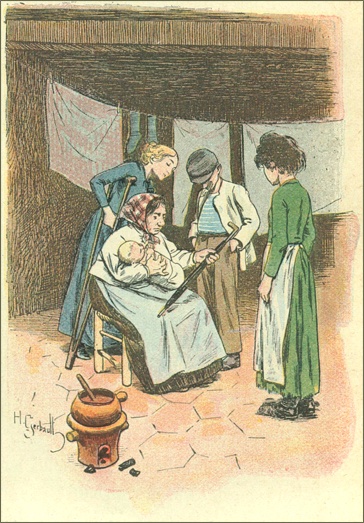
[↔]
«D’OÙ SORT CE BEAU PARAPLUIE?»
—C’est vrai, ça! Ils n’ont qu’à prendre garde à leurs affaires, ajouta
Polydore, le fils aîné. Un fameux parapluie, tout de même! Je voudrais
bien l’avoir trouvé pour mon propre compte!»
Mais la voix de la pauvre infirme s’éleva comme une petite cloche
d’argent, au son à la fois clair et doux:
«C’est égal, Fifine, tu as eu le plus grand tort de prendre ce qui ne
t’appartenait pas.
—Fallait-il le laisser au milieu des Quinconces?» murmura la coupable
en se hâtant de me faire disparaître derrière un meuble, pour mettre
fin à la discussion.
L’entretien en resta là, en effet, car personne n’avait osé contredire
Mimi, chacun retrouvant peut-être l’écho de ses paroles au fond de sa
propre conscience.
Du reste, je devais donner peu de satisfaction à ma propriétaire
d’occasion; elle craignait de m’emporter aux Quinconces, où j’aurais
pu être reconnu et réclamé, et me trouvait trop beau pour se servir de
moi lorsqu’elle allait acheter deux sous de lait chez la crémière ou un
peu de fromage d’Italie chez le charcutier; la seule fois qu’elle s’y
était risquée, une marchande ne lui avait-elle pas dit en la regardant
fixement:
«T’as vraiment un beau parapluie pour abriter tes guenilles!»
Et cette remarque profonde amena une rougeur subite sur les joues de
Fifine.
Ah! vraiment, le bien mal acquis ne profite guère! Fifine pouvait s’en
apercevoir, et bientôt elle éprouva pour sa capture illégitime une
sorte d’aversion. Rien d’inutile comme un parapluie dont on ne peut
se servir, et elle était d’autant plus vexée de n’oser faire usage du
produit de sa mauvaise action, qu’à partir du jour où elle s’était
emparée illicitement de moi, des torrents de pluie étaient tombés; or
je n’avais qu’un seul camarade dans ce misérable intérieur et l’on s’y
battait littéralement à qui l’aurait, les 18 autres, pas plus que
Fifine, ne voulant emporter ce parapluie compromettant qui attirait
sur celui qu’il abritait des réflexions désagréables et des regards
soupçonneux.
Jamais je ne menai une existence aussi sédentaire que chez les
Louriguet, tenant compagnie pendant des journées entières à l’enfant
infirme qui, toujours assidue au travail, raccommodait le linge et les
hardes de toute la famille; pauvre petite fleur éclose sur un tas de
fumier! J’aimais beaucoup Mimi, quoiqu’elle ne s’occupât jamais de moi.
Le temps pluvieux avait naturellement interrompu les représentations de
Guignol, et ce chômage forcé amenait derrière lui la famine, non pas
précisément pour Polichinelle, le commissaire et la mère Michel, qui
dormaient tranquillement dans la boîte aux accessoires, mais pour les
Louriguet grands et petits. Il ne s’agissait pas seulement de manger,
il fallait payer le logeur qui réclamait (et avec quelles menaces!)
cinq francs tous les quinze jours. Comme, faute de cette minime somme,
la famille allait être expulsée, le père Louriguet s’écria d’une voix
inspirée:
«Faut mettre quelque chose au Mont-de-Piété, pour nous faire prêter
dessus la pièce de cinq francs.... Mais quoi?
—Il y a mon parapluie, proposa Fifine.
—T’as vraiment de l’esprit, s’écria avec conviction son oncle, très
heureux de cette solution; va chercher ton parapluie, ma poulette; au
moins comme ça il servira à quelque chose, ce propre-à-rien.»
Je compris alors que le Mont-de-Piété est un établissement où l’on
prête de l’argent sur gages.
Le lendemain, mon départ ne s’effectua pas sans difficulté. On dit que
la nuit porte conseil; Fifine, rapace et égoïste, avait sans doute
réfléchi, et, revenant sur son semblant de générosité, prétendait
maintenant me garder ou bénéficier seule du produit de mon engagement
au Mont-de-Piété.
«Le parapluie est à moi, affirmait-elle avec audace, oubliant de quelle
façon elle m’avait acquis; donc l’argent doit m’appartenir!»
Des protestations générales répondirent à cette déclaration. Mais
l’oncle, très ironique dans son calme affecté:
«Ne te gêne pas, ma petite; garde ton parapluie, car il sera désormais
ton seul abri, puisque je te mets à la porte avec lui!»
Fifine, terrifiée par cette menace, n’osa résister davantage et, me
jetant aux pieds de M. Louriguet, sortit de la pièce en pleurant.
19
Alors Mme Louriguet, me ramassant tranquillement, m’emporta au
Mont-de-Piété, où assurément elle n’allait pas, comme moi, pour la
première fois.
IV
AU MONT-DE-PIÉTÉ ET CHEZ MADAME GRÉGOIRE
Il s’agissait d’une sorte de prison. On me mit dans un grand magasin
sombre où il y avait des objets de toute espèce.
On voyait là des pianos, des buffets, des coffres à bois, des
consoles, des sièges de toute grandeur et de toute forme, depuis le
petit tabouret jusqu’au large fauteuil Louis XIV; puis c’étaient des
montres accrochées les unes à côté des autres dans une vitrine; ah!
que de montres, que de montres!... Les pendules ne manquaient pas non
plus. Une machine à coudre, trésor de quelque pauvre ouvrière, et
une cage dorée, qui avait dû orner un élégant boudoir, se côtoyaient
fraternellement; un peu plus loin, on apercevait une guitare, un
trombone, deux flûtes et un accordéon, formant tout un orchestre; puis
on voyait des lampes, des vases de fleurs, des lustres, une baignoire
perfectionnée et une foule de bibelots dont l’énumération serait
fastidieuse.
Le jour, sous la lumière terne et blafarde qui tombait des rares
fenêtres grillées, ce capharnaüm avait quelque chose de lugubre. Les
employés allaient et venaient, au milieu de ces épaves, insouciants
et affairés, enlevant celle-ci, apportant celle-là, et puis, à un
signal, ils se retiraient tous, fermant soigneusement les portes,
qu’assujettissaient, en sus des barres de fer, de doubles fermetures
très compliquées. Mais lorsque le silence s’était fait, que les pas et
les voix des hommes avaient cessé de retentir, alors une vie nouvelle
très faible, quelque chose comme un reflet de vie plutôt, s’emparait
de tous ces objets qui avaient tenu leur place dans des existences
humaines. J’entendais des chuchotements légers comme jadis dans le
magasin de mon enfance, mais ces derniers racontaient ordinairement des
histoires très tristes.
Les vieux meubles parlaient de pauvres gens, leurs humbles
propriétaires, qui avaient été obligés de se séparer d’eux pour avoir
du pain; les jolis bibelots s’entretenaient de personnes ruinées, plus
malheureuses encore peut-être, cachant leur misère et sacrifiant leurs
plus chers souvenirs aux nécessités du présent.
Une nuit, nous vîmes une vive clarté dessiner soudain les barreaux de
fer des fenêtres sur un fond rouge.
«Serait-ce déjà le jour?» murmurâmes-nous fort étonnés que la nuit eût
passé si vite.
Mais un arrosoir qui devait avoir une grande expérience s’écria
aussitôt:
«Je crois que c’est le feu, car j’ai servi dans un incendie, et je me
souviens de ces lueurs intermittentes.»
20
Un vieux télescope et une jeune lorgnette vérifièrent le fait, et, à
notre très grande inquiétude, un porte-voix de navire annonça d’une
manière sinistre que le feu était à un baraquement voisin de notre
magasin, où on serrait les objets de literie.
On devine que l’anxiété ne tarda pas à régner parmi nous. Allions-nous
périr dans les flammes?

[↔]
«IL FAUDRA DÉMÉNAGER LES GAGES!»
Cependant des appels, des pas précipités se faisaient entendre. Bientôt
nos portes s’ouvrirent avec fracas et quelqu’un dit:
«Si on n’est pas maître du feu d’ici à dix minutes, il faudra songer à
déménager les gages et à les mettre en lieu sûr!»
Je compris qu’il s’agissait de nous et que le vieux monsieur qui
parlait devait être le directeur de l’établissement. Il s’exprimait
avec beaucoup d’autorité et avait un air très digne malgré le bonnet
de coton qui ornait encore son front; sans doute, notre protecteur,
réveillé en sursaut, n’avait pas eu le temps d’ôter son couvre-chef.
Heureusement l’incendie fut vite circonscrit, et il ne fut pas
nécessaire de déménager le magasin.
Après cet incident, tout retomba dans un calme plat. Je soupirais après
une bonne petite averse bien ruisselante; j’avais la nostalgie du
dehors.
Une fois que je me laissais aller, en entendant tomber une giboulée de
mars, à exprimer ce regret, une voix miaulante me répondit:
«Il n’y a pourtant rien de plus désagréable que de se faire mouiller.»
Et j’aperçus un gros chat jaune et blanc, admirablement empaillé, qui
me considérait de ses yeux de verre.
«Chacun a son goût, répliquai-je un peu sèchement; moi, j’aime la
pluie.»
Puis, honteux de mon aigreur:
«Y a-t-il longtemps que vous êtes ici?
—On m’a déposé il n’y a qu’un instant.
—Eh bien, vous éprouverez qu’à la longue on s’ennuie en prison.
—Je ne dédaignais pas une promenade sur les gouttières lorsque j’étais
jeune, je vous assure, mais quand il faisait un temps bien sec; cela
désespérait cette pauvre Pétronille.
—Pétronille! je connais ce nom-là et il me semble que je vous ai déjà
vu quelque part, mais je ne vous reconnais pas complètement; si j’osais
vous demander votre nom?
21
—Je me nommais Mousquetaire, articula le chat jaune avec une
mélancolie solennelle, alors que j’appartenais à Mme veuve Trofé.
—Parfaitement! je me souviens maintenant; vous dormiez toujours sur
un coussin au coin de la cheminée de cette dame. Ça n’a pas dû vous
changer beaucoup d’être empaillé?
—Vous vous trompez; cela n’est plus du tout la même chose.
—Et comment ce malheur vous est-il arrivé?

[↔]
PÉTRONILLE ÉPOUSA L’EX-SERGENT.
—Je suis mort d’une indigestion; alors ma maîtresse désolée, voulant
me conserver sous ses yeux, se décida à me faire empailler.
—Vous êtes très réussi, lui dis-je poliment.
—Vous trouvez? Ma maîtresse, cependant, jugea qu’elle n’en avait pas
pour son argent....
—Pardon si je vous interromps, monsieur Mousquetaire, mais je voudrais
savoir si vous avez revu chez Mme Trofé ma petite amie Marthe Duvignot.
—Oui, je l’ai aperçue une ou deux fois, quoique les relations entre
ces dames et ma maîtresse aient subi un certain refroidissement au
sujet du jeune Duvignot; mais je crois que les choses étaient à peu
près arrangées quand Mme Trofé mourut, car je sais qu’elle a laissé une
petite rente à sa filleule.
—Je suis bien aise de l’apprendre; Marthe est une charmante enfant.
—Mais elle n’hérita pas seule de Mme veuve Trofé; un parent de
cette dame eut la plus grosse part de son modeste avoir, et la bonne
Pétronille ne fut pas oubliée sur le testament; outre une jolie somme
d’argent, le mobilier d’une chambre à coucher lui était laissé avec le
droit de choisir encore quelques souvenirs à son gré.
22
«Ainsi autorisée par les dernières volontés de la défunte, la digne
fille emporta une pendule en coquillage, la couronne de mariée de
sa maîtresse, mise sous verre et encadrée, et enfin moi-même, votre
serviteur.
«L’héritier ne fit aucune opposition; il la félicita même
chaleureusement de ses choix et poussa la générosité jusqu’à lui payer
le commissionnaire chargé de porter chez elle ces précieux souvenirs.
Hélas! ils ne devaient pas y rester longtemps. Pétronille qui, malgré
ses quarante ans, songeait au mariage, avait jeté son dévolu sur un
jeune militaire qui venait précisément de quitter le service. La noce
se fit sans retard; je vis Pétronille partir radieuse pour la mairie
et l’église; huit jours plus tard, elle n’était plus radieuse du
tout; son Auguste (ainsi s’appelait l’ex-sergent-fourrier), gourmand,
ivrogne et paresseux, la délaissait pour aller festoyer avec ses
anciens camarades, et les économies de la pauvre femme disparaissaient
rapidement.
«Un jour Mme Auguste fut appelée dans une ville voisine auprès d’une
parente malade.
«Pendant son absence, son mari, n’ayant pas d’argent, prit un grand
panier (le panier pour faire le marché de l’ancienne cuisinière), y
posa avec précaution la pendule de coquillage, la couronne de mariée
et moi, et nous porta tout droit au Mont-de-Piété. Peu s’en fallut que
nous n’en revinssions tous, car on ne voulait pas de nous; enfin, après
bien des négociations, je fus accepté, ainsi que la pendule; mais ni
elle ni moi nous ne resterons longtemps ici, car je suis bien sûr que
Pétronille ne tardera pas à venir nous retirer.
—J’espère que vous retrouverez cette digne personne à laquelle vous
devez être attaché.
—Je l’espère aussi, car je me sens beaucoup mieux chez elle qu’ici.»
Mousquetaire avait terminé son histoire et je me préparais à lui
raconter la mienne, ce qui ne l’aurait peut-être guère intéressé (les
chats sont si égoïstes que même empaillés ils doivent l’être encore),
lorsque les employés de l’établissement entrèrent pour le travail du
matin.
Il devait y avoir une vente d’objets non réclamés dans l’après-midi,
et je vis, avec une émotion facile à deviner, que je faisais partie du
lot, car on posa sur moi une étiquette avec un numéro. Peu après, on
m’emportait avec une quantité d’objets variés, mais j’étais le seul
parapluie.
On nous déposa sur une table derrière laquelle se trouvait un monsieur
qui criait comme un corbeau et frappait de petits coups secs avec un
marteau; c’était le commissaire-priseur chargé de la vente; quelques
employés se tenaient autour de lui, tandis que dans l’autre partie de
la salle se pressait une foule peu élégante.
Il y avait là plusieurs vieilles dames assez mal habillées et des
messieurs qui paraissaient fort pauvres.
Parmi les dames présentes, une d’elles me frappa par son étrange
toilette. Elle devait être une habituée de la salle des ventes, car
j’entendis un employé l’appeler familièrement par son nom:
23
«Madame Grégoire, je vous en prie, ne poussez pas, lui disait-il; vous
êtes au premier rang; vous ne pouvez donc pas avancer davantage, à
moins de monter sur la table!»
Mme Grégoire protesta qu’elle n’en avait nullement l’intention, mais
«elle aimait à voir la marchandise de près». En effet, elle n’achetait
qu’à bon escient et semblait très forte dans cette délicate opération
qui consiste à estimer du vieux.
Dès qu’elle m’aperçut, je compris, au vif regard dont elle m’enveloppa,
qu’elle désirait faire mon acquisition.

[↔]
JE VIS QUE JE FAISAIS PARTIE DU LOT.
«Trois francs le beau parapluie! commença le commissaire-priseur.
—Il y a acheteur à trois francs», dit-elle aussitôt.
Mais un monsieur, qui lui en voulait sans doute, ajouta: «Trois francs
cinquante!» uniquement, je crois, dans le but de la taquiner.
«Quatre francs!» glapit-elle.
Puis après un instant de silence:
«Quatre francs cinquante!» reprit le monsieur en riant d’un méchant
rire.
Alors, tout en le foudroyant d’un coup d’œil furieux:
«Cinq francs!» cria-t-elle, jetant ce prix avec un éclat de trompette,
presque comme un défi.
Le monsieur ricana encore, mais n’ajouta rien, la crainte de faire une
mauvaise affaire l’emportant sur son désir d’être désagréable à sa
voisine; et le commissaire-priseur prononça le mot «adjugé», qui me
livrait à ma nouvelle propriétaire; elle s’empara de moi avec la joie
qu’un chasseur éprouve à ramasser une pièce de gibier qu’il a abattue.
J’appartenais à Mme Grégoire.
Ce fut dans une pièce sombre, toute remplie de vieux vêtements, qu’elle
m’introduisit, après avoir traversé un étroit magasin fort encombré, et
je compris que Mme Grégoire était ce qu’on appelle «une marchande à la
toilette».
Vers huit heures du soir, la marchande éteignit les becs de gaz, et,
après une ronde minutieuse, sa petite lanterne sourde à la main, monta
se coucher dans son entresol, au-dessus de tous ses trésors.
Le lendemain matin, Mme Grégoire vint me prendre dans mon coin noir et
me mit bien en évidence au milieu de son étalage. J’y étais à peine
depuis quelques instants, lorsqu’une petite jeune fille de quatorze ans
environ, l’air doux et modeste, la mise à l’avenant, s’arrêta devant la
montre et resta longtemps à me contempler.
24
Comme Fifine, elle me regardait avec un désir évident, mais combien
l’expression de sa physionomie candide et sérieuse était donc
différente!
Mme Grégoire, qui la guettait du fond de son magasin, s’avança
souriante.
«Y-a-t-il quelque chose pour votre service, ma belle enfant?»
demanda-t-elle de sa voix la plus engageante.

[↔]
«TROIS FRANCS LE BEAU PARAPLUIE!»
La petite se décida à entrer, et dit timidement:
«Est-ce que ce parapluie est à vendre?
—Certainement! Une magnifique occasion, voyez plutôt: un manche à la
dernière nouveauté, un satin croisé superbe et d’une si jolie couleur!
Ce vert myrte est la nuance préférée des dames du grand monde qui
fréquentent mon magasin. Ce parapluie est pour ainsi dire neuf, au
point que, si on n’était pas honnête, on pourrait le faire passer pour
sortant de l’atelier; mais je ne veux pas vous tromper: il a dû servir
deux ou trois fois.»
La jeune fille, m’examinant avec attention, se contenta de secouer un
peu la tête, sans oser entrer en discussion avec la marchande à la
toilette, et enfin lui posa la question habituelle:
«Combien, Madame?»
Puis, comme celle-ci réfléchissait, elle ajouta sur un ton presque
suppliant:
«Je vous en prie, dites-le-moi au plus juste.
—Dix francs, articula nettement Mme Grégoire, n’ayant pas honte
de profiter du vif désir de m’acquérir qui se lisait sur le visage
expressif de l’enfant.
—Dix francs! répéta d’un accent découragé cette dernière en me
reposant sur le comptoir avec un soupir.
25
—Mais voyez comme il est beau! C’est un parapluie extra qui a dû être
payé vingt-cinq francs.
—Je ne dis pas, Madame; mais il m’est impossible d’y mettre ce
prix-là; c’est un cadeau que je voulais faire.
—Eh bien, ce sera un petit sacrifice; vous n’en aurez que plus de
mérite vis-à-vis de la personne à laquelle vous destinez votre présent.
C’est une personne que vous aimez, pour sûr?
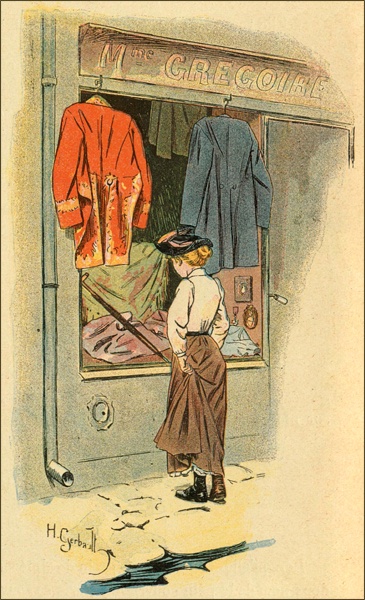
[↔]
UNE JEUNE FILLE S’ARRÊTA DEVANT LE MAGASIN.
—Oh oui!
—Eh bien, ma petite, il ne faut jamais regretter de dépenser de
l’argent pour ceux qu’on aime!
—Mais si on n’a pas cet argent, pourtant?...»
La marchande comprit que la jeune fille était sincère, son charmant
visage, soudain attristé, le révélait assez; on y lisait clairement son
regret de ne pouvoir faire l’achat.
«Allons, combien pouvez-vous y mettre, ma mignonne? je veux tâcher de
vous être agréable.
—Six francs, murmura la petite fille. Voyez-vous, Madame, il ne faut
pas m’en vouloir si je ne peux pas vous payer plus cher ce parapluie;
j’ai eu bien du mal à réunir ces six francs, et je croyais que c’était
déjà une grosse somme, car j’ai mis presque un mois à l’économiser
sur mes déjeuners. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire; voici
toute l’affaire: Le matin quand je vais à l’atelier, je n’emporte
qu’un morceau de pain, mais maman, avant de s’en aller de son côté en
journée, (nous ne sommes pas riches du tout et maman travaille pour
un magasin).... Où est-ce que j’en étais?... Ah! voilà: maman, avant
que nous nous séparions, me donne trois ou quatre sous pour m’acheter
quelque chose afin de faire passer mon pain: un peu de charcuterie, du
fromage, quelques fruits, selon la saison. Eh bien, depuis longtemps
je mange mon croûton tout sec, car je mets les sous dans un petit
sac que je cache sous mon traversin, et comme c’est 26 demain la
Sainte-Mathilde, qui est la fête de maman (j’oubliais de vous dire que
tout ça, c’était pour faire une surprise à maman), donc j’ai changé
mes sous au marchand de journaux du coin, et j’étais bien embarrassée
pour trouver mon cadeau quand j’ai vu ce parapluie; c’était justement
ce qu’il me fallait, car ma mère a perdu le sien; mais puisque ça ne se
peut pas, je m’en vais tout de suite.
—Attends!» dit la marchande, qui semblait maintenant émue et troublée.
«Elle ressemble à ma petite Esther», murmurait-elle en jetant sur
l’enfant un regard mouillé.
Puis comme celle-ci reculait surprise, effrayée de l’attitude
incompréhensible de la marchande:

[↔]
«DONNE-MOI TES SIX FRANCS!»
«J’ai eu une jolie petite fille comme toi; je l’ai perdue lorsqu’elle
avait ton âge et tu me la rappelles.»
Puis brusquement:
«Prends ce parapluie; j’y perds, dit-elle par habitude, mais prends-le
tout de même et donne-moi tes six francs.»
D’un mouvement machinal elle m’enveloppa dans un grand morceau de
papier bleu, et me remit à la jeune ouvrière, dont le visage rayonnait
de joie.
«Dieu vous bénisse, Madame! lui dit-elle. Maman va être bien contente.»
Elle se sauva, laissant l’âme de la vieille marchande en proie à deux
sentiments contradictoires: la conscience d’avoir fait une action très
généreuse, quoique en réalité elle eût gagné un franc sur moi, et le
regret d’une mauvaise affaire réalisée.
V
LA FÊTE DANS LA MANSARDE
Lorsqu’elle eut quitté le magasin de Mme Grégoire, Marie (j’ai su
depuis que tel était le doux nom de la petite ouvrière), Marie se
souvint qu’il lui restait encore deux sous noués dans le coin de son
mouchoir, et que ces deux sous étaient destinés à l’achat d’un petit
bouquet de violettes qui devait achever de donner au parapluie l’aspect
d’un présent de fête.
En effet, quand elle eut trouvé le petit bouquet en question, qu’elle
choisit bien frais et bien odorant, elle l’attacha après moi au moyen
d’un ruban et nous monta triomphalement jusque dans son humble logis.
Sa mère n’étant pas encore rentrée de son magasin, la petite fille me
déposa sur 27 une table qui occupait le milieu de la pièce, bien
en évidence, afin que ma vue frappât tout d’abord les yeux de celle
qui était attendue; d’ailleurs le parfum des violettes eût suffi pour
attirer son attention.
Les choses ainsi préparées, l’enfant alla se mettre aux aguets derrière
la porte du réduit servant de cuisine, qu’elle eut soin de tenir
entre-bâillée, tout juste assez pour couler son regard par la fente et
jouir de l’effet produit.
Son attente ne fut pas longue. Mme Girard, chargée d’un gros paquet,
montait lentement l’escalier, et sa fille avait reconnu de loin son
pas. Trouvant la porte ouverte, elle dit, en entrant: «Tu es là, Marie?»

[↔]
«C’EST POUR VOTRE FÊTE, MADAME GIRARD!»
Mais Marie se garde de répondre; alors, jetant un coup d’œil autour
d’elle, humant l’air, comprenant qu’il se passe quelque chose et
se rappelant vaguement que c’est demain sa fête, la mère s’avance
en souriant, ne croyant encore qu’à un petit bouquet. Vraiment les
fleurs sont là, mais en voulant les prendre, elle m’attire par le même
mouvement.
«Ah! mon Dieu, qu’est-ce cela? Ce beau parapluie ne peut être pour moi.
—Mais si! Maman, c’est pour ta fête! s’écrie Marie qui n’y tient plus
et apparaît rouge de plaisir.
—Mais, ma chérie, comment as-tu fait?
—Ah! voilà, Maman, je ne puis pas te le dire; c’est mon secret.
—Il est bien joli, et justement je regrettais tant de m’être laissé
voler le mien! Seulement je ne comprends pas comment tu as pu acheter
une chose aussi chère.
—C’est mon secret, c’est mon secret! répète l’enfant. L’essentiel
est que tu sois contente du parapluie; il paraît que le vert est une
couleur très à la mode; je ne le savais pas, mais la marchande me l’a
dit. Ah! que je suis heureuse, Maman, d’avoir deviné ce qui pouvait te
faire plaisir!
—Ce qui me fait encore plus de plaisir que le parapluie, c’est ton
attention et c’est aussi de voir que tu as pensé à ma fête; pour moi,
je l’avais oubliée: j’ai tant de choses dans la tête! Embrasse-moi,
mon enfant, et puis maintenant dis-moi comment tu as pu faire cette
emplette», insista doucement Mathilde en tenant sa fille appuyée sur
son cœur.
Il fallut bien se confesser, et quand la mère découvrit, à travers
les réticences de l’enfant, qui cherchait à lui voiler délicatement
ses sacrifices, combien la pauvre petite s’était privée pour arriver
à économiser la somme nécessaire à ce présent, une profonde émotion
souleva sa poitrine.
«Tu as fait cela, tu as fait cela!» ne savait-elle que répéter en
couvrant ce visage aimé de tendres baisers.
Ici, un petit coup discret frappé à la porte interrompit cette
touchante effusion.
28
«C’est notre bonne voisine», murmura Mathilde.
Et, à haute voix:
«Entrez, je vous prie.»
La porte fut poussée et une vieille femme très proprette pénétra
dans la chambre en se soutenant sur deux béquilles qui faisaient
toc-toc en frappant le plancher. A cette vue, à ce bruit
familier, les visages de la mère et de la fille s’épanouirent dans un
joyeux sourire.
«Bonjour, Mademoiselle Agathe!» s’écrièrent-elles ensemble.
Et la première avançait son unique fauteuil à la vieille fille, tandis
que l’autre la débarrassait de ses béquilles.
Une fois installée, la visiteuse tira de chacune des poches de son
tablier une orange en disant:
«C’est pour votre fête, Madame Girard, car je n’ai pas oublié que c’est
demain la Sainte-Mathilde.
—Mais vous vous privez pour nous!
—Du tout; mon ancien maître m’en a envoyé une douzaine; il paraît,
à ce que m’a dit la bonne, qu’il en a reçu toute une caisse d’un de
ses clients qui habite en Espagne, où il y en a comme des pommes en
Normandie.»
Après avoir beaucoup remercié Mlle Agathe, Mathilde lui montra le
parapluie de Marie, en disant d’une voix pénétrée:
«Ah! on me gâte bien, aujourd’hui; voyez plutôt!»
Et, avec un redoublement d’émotion, elle lui raconta comment Marie
était parvenue à lui faire ce cadeau.
La vieille fille approuva fort l’enfant et dit «que c’était très gentil
de sa part», mais il eût fallu être mère soi-même pour apprécier à sa
juste valeur un trait de ce genre.
C’était, du reste, une fort bonne personne que Mlle Agathe, et l’unique
amie de Mme Girard, près de laquelle elle habitait depuis déjà
plusieurs années. Son petit appartement, composé de deux pièces bien
meublées, semblait un endroit luxueux aux pauvres ouvrières; de doubles
rideaux aux fenêtres, un bout de tapis devant la cheminée, ornée d’une
pendule sous un globe, une table et une commode de simili-acajou,
enfin, 29 sur le lit, enfoncé dans une alcôve, un édredon recouvert
de fausse guipure étaient les causes principales de l’admiration que
leur inspirait toujours l’intérieur de leur voisine, au point que, la
trouvant si bien installée, elles ne songeaient guère à la plaindre de
ne pouvoir sortir de chez elle.
Cette dernière s’était d’ailleurs quelque peu habituée à son
emprisonnement, qui datait du jour funeste où, glissant sur une peau
d’oignon, dans la cuisine du docteur Durand, elle s’était cassé la
hanche d’une manière si malheureuse que, malgré les soins de son
maître, réunis à ceux de plusieurs praticiens de ses amis, après avoir
failli mourir, elle restait infirme à jamais. Naturellement elle avait
dû cesser de travailler et, à son grand désespoir, quitter la maison du
docteur; elle y avait vécu pendant quinze ans, ayant d’abord servi et
soigné sa mère, puis servi M. Durand lui-même.
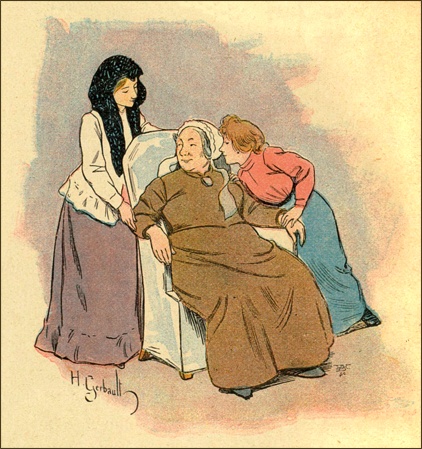
[↔]
Mlle AGATHE FUT INSTALLÉE DANS LE FAUTEUIL.
Le docteur sut reconnaître les services d’Agathe en lui allouant une
petite pension, à laquelle il ajoutait des cadeaux en nature, qui
ravissaient la vieille bonne. Possesseur d’une belle terre située à
quelques heures de Bordeaux, il lui envoyait d’abord régulièrement une
provision de vin et de bois, puis, de temps en temps, un poulet de sa
basse-cour ou des légumes de son jardin. Quand il y avait une bonne
aubaine culinaire de ce genre, Agathe ne manquait pas de se traîner sur
ses béquilles jusque chez ses voisines, et de les inviter à dîner, avec
quelque solennité.
Ces jours de gala étaient grande fête pour la mère et l’enfant, pour
l’enfant surtout, qui considérait qu’elle allait «dîner en ville»; cela
rompait un peu la monotonie de leur existence et leur faisait faire
connaissance avec des plats délicats, dont leur pauvreté les privait.
Du reste, elles reconnaissaient les attentions de leur vieille voisine
en lui rendant mille petits soins. Une femme de ménage venait bien, une
heure chaque matin, faire un bout de service auprès de l’infirme, lui
apportant ses provisions, montant son eau et son bois, mais, une fois
le lit fait et la chambre balayée, elle ne reparaissait plus jusqu’au
lendemain, et Mlle Agathe eût été souvent fort en peine, pour bien des
détails de son existence, sans l’aide de ses voisines. Elle leur avait
même donné une double clef de son logis, afin qu’elles pussent pénétrer
facilement jusqu’à elle la nuit, en cas de maladie. La vieille femme
devait en guise d’avertissement frapper à la muraille contre laquelle
son lit s’appuyait; 30 mais, quoique tout eût été ainsi parfaitement
prévu, jamais encore ce signal ne s’était fait entendre, et ce ne fut
pas Agathe qui eut, la première, besoin d’une garde-malade.
VI
LA MALADIE CHEZ LE PAUVRE
Entre sa charmante petite fille et sa vieille amie, Mathilde, en dépit
de sa pauvreté, menait une existence fort douce, lorsqu’un orage
inattendu vint éclater dans son ciel limpide.
Elle travaillait, je l’ai déjà dit, pour un magasin; or, un vol de
fournitures ayant été commis dans son atelier, Mme Première (ainsi
qualifiait-on la personne qui dirigeait les ouvrières) s’avisa de faire
tomber ses soupçons sur l’honnête veuve, qui était incapable de dérober
une aiguillée de fil.
Tout le monde protesta d’ailleurs contre une accusation si mal fondée,
et ce furent ces protestations mêmes qui firent comprendre à Mathilde
de quoi elle était soupçonnée. On crut qu’elle allait défaillir, tant
son émotion fut grande, mais l’indignation la soutint.
Non seulement elle sut se défendre, mais elle sortit de cette scène
pénible, couverte par le témoignage d’estime absolue du chef de
l’établissement, qui obligea Mme Première, assez confuse, à faire des
excuses à Mme Girard. N’importe, le coup était porté; elle rentra chez
elle plus tôt que d’habitude, absolument bouleversée, racontant à Marie
et à Mlle Agathe, avec une véhémence tout à fait en dehors de ses
habitudes, ce qui s’était passé.
Mathilde, que ces émotions avaient épuisée, se mit au lit. A peine
la tête sur l’oreiller, elle tomba dans un lourd sommeil. Alors Mlle
Agathe se retira chez elle, tandis que la petite fille prenait toute
seule son repas du soir. Il fut vite terminé; après avoir débarrassé
la table et lavé le peu de vaisselle dont elle s’était servie, Marie
s’assit de nouveau près de la lampe et se mit à raccommoder des bas.
Il y avait environ une heure qu’elle travaillait, lorsqu’elle vit sa
mère se retourner plusieurs fois, s’agiter, soupirer. Alors, croyant
qu’elle se réveillait:
«Eh bien, Maman, comment te sens-tu après ce petit somme? Es-tu mieux
maintenant?»
Point de réponse, sinon un murmure inarticulé.
«Je ne comprends pas ce que tu dis. Veux-tu boire encore un peu d’eau
sucrée? il en reste dans le verre.»
Mathilde tourna vers sa fille un visage très rouge et dit plus
distinctement:
«Les fils blancs étaient dans la grande boîte, les extra-forts dans le
carton long. Mlle Baptistine les a vus comme moi; si on s’imagine que
j’ai pris quelque chose, qu’on me mène chez le commissaire de police,
mais qu’on ne dise rien à Marie, la pauvre petite!
31
—Maman, Maman, je suis là, qu’est-ce que tu as? est-ce que tu ne me
reconnais pas?
—Conduisez-moi chez le commissaire de police, ou allez le chercher!
—Ah! mon Dieu! elle ne me reconnaît pas! Mère, tu me fais peur; ta
main est brûlante.
—Laissez-moi; personne dans ma famille n’a jamais été en justice; j’en
mourrai, c’est sûr!»
Marie n’y tint plus; d’un bond elle courut chez Mlle Agathe, et,
en paroles entrecoupées, lui raconta que sa mère délirait et ne la
reconnaissait même pas.
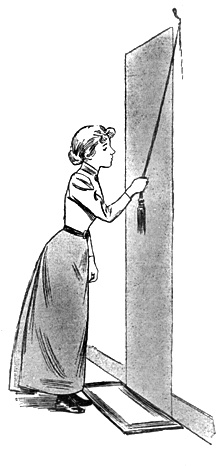
[↔]
MARIE SONNA A LA PORTE DU SECOND.
«Elle a été trop impressionnée par cette histoire du magasin; je m’en
suis aperçue quand elle est rentrée; je vais me lever et me rendre
auprès d’elle, nous verrons ensuite ce qu’il y aura à faire; tu sais
que je m’y connais, en fait de maladie.
—Ah! merci, Mademoiselle Agathe; je voudrais vous aider à vous lever,
mais je n’ose la laisser seule.
—Retourne tout de suite auprès de ta mère; je serai bientôt près de
toi; je ne prends que le temps de passer un jupon et une camisole.»
Marie se hâta de rentrer chez elle, où sa mère continuait à parler et à
s’agiter, s’adressant à des personnages imaginaires et regardant dans
le vide. Ce fut ainsi que Mlle Agathe la trouva.
Alors, lui parlant avec autorité, cette dernière la força à boire de
l’eau avec de la fleur d’orange et obtint qu’elle se recouchât.
«Ce sont les nerfs», assura-t-elle d’abord à l’enfant, qui
l’interrogeait avec anxiété, pour dire quelque chose; mais elle avait
constaté que Mathilde était en proie à une fièvre ardente, et elle
comprenait que son état devait être sérieux.
Après être restée un moment silencieuse au chevet de la malade, elle
dit, en hésitant un peu, car elle savait bien qu’il s’agissait d’une
chose difficile:
«Je crois qu’elle aurait besoin d’un médecin.
—Mais je n’en connais aucun! s’écria Marie avec angoisse.
—Oh! quant à cela, il y a mon ancien maître qui est bon, et puis si
savant qu’il en remontrerait à tous les autres docteurs; on venait le
consulter de loin quand j’étais à son service.
—Vous croyez qu’il se dérangerait pour de pauvres gens comme nous?
—J’en suis sûre! Monsieur avait coutume de dire qu’en fait de malades
il ne connaissait ni riche ni pauvre, mais que c’était tout un pour
lui; le difficile, c’est de le faire demander; quoiqu’il ne demeure pas
bien loin, il y a encore un bout de chemin pour aller jusque chez lui.
Voyons, quelle heure est-il?»
On consulta la grosse montre d’argent du mari défunt, dont se servait
maintenant sa veuve et qu’elle suspendait à un clou au-dessus de la
cheminée, en guise de pendule. 32 Il était déjà 10 heures 20, heure
qui semblait tardive à ces personnes de condition modeste, habituées à
se coucher tôt pour se lever de bon matin.
Mlle Agathe, après réflexion, dit à Marie:
«La bonne qui garde le premier et le second en l’absence de ses
maîtres, lesquels sont à la campagne, n’est peut-être pas encore
couchée; prie-la d’aller chercher M. le docteur, et, si elle grogne
(car elle n’est guère aimable), offre-lui la pièce, pour la décider.
—Oh! Mademoiselle Agathe, je voudrais bien, mais je n’oserai jamais!»
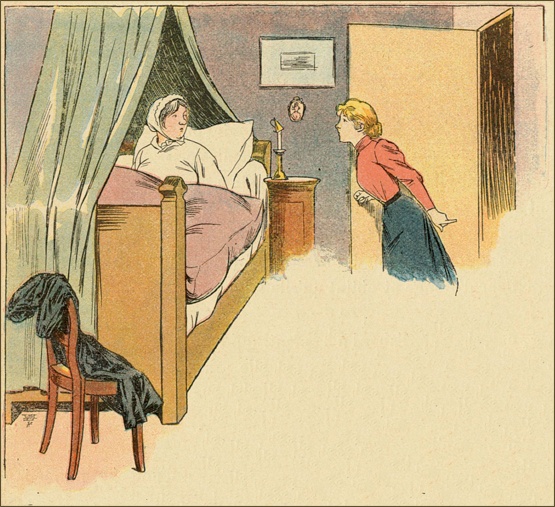
[↔]
MARIE ALLA CHEZ Mlle AGATHE.
Cependant la malade recommençait à se plaindre et à délirer, et Marie,
sentant elle-même combien sa mère avait besoin de secours, se décida à
aller réclamer l’aide d’une seconde voisine, quelque pénible que pût
lui sembler cette démarche.
Descendant en hâte deux étages (la maison en avait quatre, mais le
troisième n’était pas loué en ce moment), elle sonna un coup timide à
la porte du second.
Point de réponse.
Elle renouvelle sa tentative en l’accentuant un peu. Même silence.
Enfin un troisième coup, sonné avec le courage du désespoir, n’a pas
plus de succès.
Désolée, elle remonta chez elle raconter sa déconvenue à Mlle Agathe.
«Ne te fais pas de peine, ma petite, essaya de dire celle-ci; ta maman
va peut-être se trouver mieux, et demain, de bonne heure, tu iras
chercher M. le docteur.»
Cependant Mathilde ne se calmait pas du tout; elle se jetait de côté
et d’autre dans son lit en se plaignant continuellement. Mlle Agathe
eut alors l’idée de lui mettre des compresses d’eau fraîche, qui la
soulagèrent un instant, mais bientôt la malade ne voulut plus les
supporter et se reprit à gémir.
L’enfant considérait sa mère dans un morne silence, la laissant soigner
par la vieille fille. Soudain elle se leva toute droite, l’air résolu:
«Mademoiselle Agathe, dit-elle, je vais chercher le médecin.
33
—Mais, ma petite, il est trop tard pour qu’une fillette de ton âge se
risque seule dans les rues; j’ai entendu sonner onze heures, il y a
déjà longtemps; il pourrait t’arriver quelque chose.
—Il ne peut rien m’arriver de pire que de voir mourir sans secours ma
pauvre chère maman. Elle est très malade; vous dites vous-même qu’il
lui faut un médecin: je cours chercher votre docteur.
—Mon enfant, c’est imprudent, cependant il est vrai que ta mère...,
enfin je ne sais que te dire, mais je n’ai jamais été plus fâchée de
mon infirmité qui me rend si inutile.
—Inutile! bien au contraire, vous me rendrez grand service si vous
restez auprès de maman pendant que je serai dehors.
—Je te promets que je ne la quitterai pas; tu peux en être certaine.
—C’est tout ce qu’il me faut, murmura l’enfant en mettant
précipitamment ses vêtements pour sortir.
—Prends ton parapluie; il pourrait pleuvoir, et puis, si tu
rencontrais un chien errant, il te servirait pour l’écarter.»
Grâce à cette recommandation, Marie m’emporta avec elle, quoique en
réalité le temps ne fût guère menaçant, et c’est ainsi que j’assistai à
sa petite mais très héroïque expédition.
Bien peu de maisons à Bordeaux ont des concierges; celle où Mme
Girard et sa fille habitaient n’en avait pas. Marie, ayant descendu
l’escalier en courant, ouvrit la porte d’entrée d’un mouvement rapide
et la referma derrière elle. Mais, une fois dans la rue, elle s’arrêta,
saisie d’un petit frisson de crainte; cette rue solitaire, avec ses
fenêtres closes et ses magasins fermés, éclairée de loin en loin par
des réverbères vacillants, lui faisait un effet étrange à cette heure
où elle ne la voyait jamais. Son aspect lui paraissait nouveau, ce
n’était plus sa rue, mais une voie étrangère qu’elle ne reconnaissait
pas. Du reste, personne sur la chaussée ni sur les trottoirs. Elle
fit un effort, et, surmontant sa crainte, se mit en route, rasant les
maisons comme si elle eût voulu s’appuyer aux murailles.
Sa marche était inégale: tantôt elle se précipitait en avant, songeant
à sa mère, au médecin qu’il fallait lui amener; tantôt, pensant à ses
propres périls, elle s’arrêtait, écoutait, jetait un regard inquiet
par-dessus son épaule, car il lui semblait toujours entendre marcher
derrière elle; cependant elle finit par découvrir qu’elle prenait les
battements de son cœur pour un bruit de pas.
Elle court maintenant, regardant toujours autour d’elle, suspendant
sa course au moindre bruit, soutenue par cette pensée qu’elle est
près d’atteindre son but. Elle se trouve, en effet, sur le Quai de
Bourgogne, où habite le docteur Durand. Hélas! à peine s’y est-elle
engagée, qu’une troupe bruyante, formée de plusieurs hommes, chantant
et criant, se présente en face d’elle, suivant le même trottoir. Pour
le coup, sa frayeur prend une forme bien positive.
Que faire? Que faire, mon Dieu?
34
Elle ne sait et reste là, fascinée comme un pauvre petit passereau qui
a vu planer des oiseaux de proie. Et la distance qui la sépare encore
de ces hommes effrayants diminue toujours; elle ne bouge pas, il est
vrai, mais ils avancent, eux. Soudain, éperdue, elle s’élance du côté
du fleuve; je frémis dans sa main: va-t-elle, dans son affolement,
se précipiter dans la Garonne en m’entraînant avec elle? J’aime bien
l’eau, mais pas dans une si grande proportion.... Non, Marie n’a pas
perdu l’esprit à ce point, mais elle a aperçu un wagon de marchandises,
et c’est à l’abri de ce rempart qu’elle a résolu de se réfugier; en
effet, elle se cache derrière le wagon et reste coite comme un lièvre
au gîte.
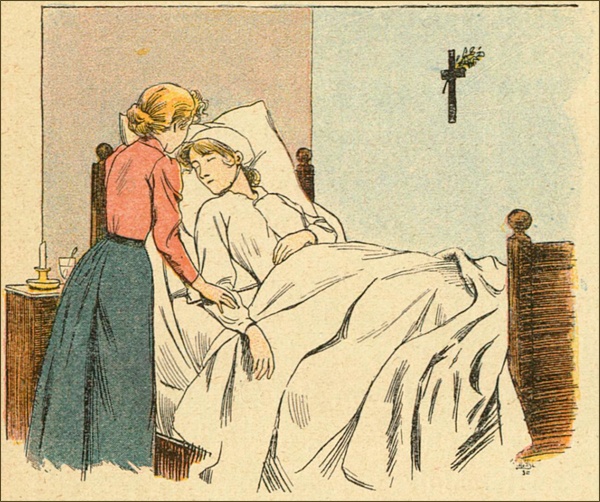
[↔]
«COMMENT TE SENS-TU, MAMAN?»
Nous étions là depuis une ou deux minutes lorsque soudain les voix de
tout à l’heure se font entendre de nouveau, et, cette fois, tout près
de nous.
«Ah! Seigneur, je suis perdue! pense la pauvre petite; ces gens me
poursuivent: sans cela pourquoi n’auraient-ils pas continué leur
chemin? Ils vont me tuer et puis me jeter dans la Garonne!»
Elle se dresse debout, mais ne songe pas à fuir, à quoi bon? on la
rattraperait si facilement! et puis elle est presque sans souffle,
l’émotion l’oppresse et ses jambes tremblantes ne pourraient seulement
pas la soutenir si elle ne s’appuyait sur moi.
«Qui est là? s’écrie un homme petit et gros.
—Tiens! une gamine, reprend un grand blond; qu’est-ce qu’elle peut
faire à cette heure-ci le long de l’eau?
—Faut la faire s’expliquer, Maître Thomas, dit un troisième en parlant
au petit gros.
—Peut-être qu’elle se promène à la fraîche», remarque un jeune garçon
qui fait aussi partie de la troupe.
Marie ne dit rien; elle a tellement peur qu’elle ne peut articuler
un son; ses yeux à demi clos ne lui permettent même pas de voir que
les physionomies rudes et grossières qui l’entourent ne sont pas bien
féroces.
«Réponds, que fais-tu là? reprend le petit gros sur un ton impératif.
—Elle cherche sa langue qu’elle a perdue, dit le jeune garçon, parlant
pour elle.
—Silence, Mousse!» Puis, à Marie: «As-tu fini de te taire, petite?
—Faut l’emmener sur le navire faire un tour en Chine, ça l’apprendra à
se donner des airs de mijaurée.
35
—Ah! mon Dieu, ayez pitié de moi! Qui ira chercher le médecin pour
maman qui est malade, si vous m’emmenez sur un navire?»
Marie s’est jetée à genoux; elle parle maintenant, et ces hommes
inconnus qui se pressent autour d’elle, l’écoutent avec stupeur.
«Fini de rire! reprend maître Thomas. Relève-toi, ma petite; faut faire
sa prière qu’au bon Dieu, et puis nous sommes de braves gens de marins,
tu sais, de bons Français, embarqués sur la Marie-Louise; n’aie
donc pas peur et raconte ton histoire sans mentir; t’as quelqu’un de
malade à ton bord, que tu parlais de médecin?
—Maman, ma pauvre maman», sanglote Marie, partagée entre un reste
de terreur et un commencement de confiance, et pensant de nouveau au
but de son expédition; «elle est bien malade et j’allais chercher le
docteur.

[↔]
MARIE EXPOSA SA REQUÊTE A M. DURAND.
—Pourquoi n’as-tu pas demandé à quelqu’un de s’y rendre à ta place? Tu
es trop jeunette pour courir toute seule la nuit.
—Il n’y avait personne là, mon bon Monsieur, excepté Mlle Agathe.
—Eh bien, Mlle Agathe ne pouvait-elle pas prendre la peine...?
—Elle ne peut pas marcher, ou très difficilement, et avec ses
béquilles seulement.
—Je comprends, elle est infirme, ta Mlle Agathe; comme ça, tout
s’explique. Et où demeure-t-il, ton docteur?
—Ici tout près, sur le Quai de Bourgogne, au numéro 15.
—Je vais t’y accompagner, car tu pourrais rencontrer de plus mauvais
compagnons que nous.
—Nous irons tous ensemble, Maître Thomas, s’écrièrent les marins en
chœur.
—Inutile de lui faire si grande compagnie, vous l’effaroucheriez, la
pauvrette; je prendrai seulement le mousse avec moi, et tandis que nous
courrons une bordée jusque chez le docteur, vous hélerez le canot du
bord. Il faut toujours un grand moment pour que ces fainéants arrivent;
je parie que je serai de retour avant qu’ils aient accosté!
—Ça se pourrait, Maître; ils ne sont pas pressés, surtout quand ils
ont sommeil.
—Allons, viens, petite, et n’oublie pas ton parapluie!» dit
paternellement le vieux marin.
Nous partîmes. Marie était tout à fait rassurée quant à elle, mais plus
inquiète que jamais pour sa mère; aussi semblait-elle à peine effleurer
les pavés de ses petits pieds.
Nous arrivâmes promptement à la porte du docteur, qui, par un heureux
hasard, rentrait justement chez lui; Marie put donc lui exposer
immédiatement sa requête, et, 36 comme sa voix tremblante, ses yeux
pleins de larmes avaient ému M. Durand, il consentit à la suivre sans
même remonter chez lui. Mais quelle que fût sa hâte d’entraîner vers le
lit de la malade celui qu’elle considérait d’avance comme un sauveur,
ma jeune maîtresse prit le temps de remercier le brave marin qui lui
causait, quelques instants auparavant, une si grande épouvante.
VII
COURTE ENTREVUE AVEC UNE AMIE D’ENFANCE
Mlle Agathe ne s’était pas trompée; Mathilde avait grand besoin du
médecin, mais, grâce au courage, au dévouement de sa fille, il arrivait
encore à temps, et une médication très prompte, très énergique,
put enrayer la maladie qui avait si brusquement terrassé la pauvre
ouvrière. Elle se remit même assez vite, à la grande joie de sa fille,
et put reprendre son travail.

[↔]
UNE TROUPE JOYEUSE BARRE LE TROTTOIR.
Chaque matin, à moins que le temps n’offrît pas la moindre chance de
pluie, je l’accompagnais, et je revenais avec elle le soir, moment de
délassement, de douce réunion entre la mère et la fille.
Ce fut une période heureuse et paisible dans mon existence toujours
exposée de parapluie, et j’aurais voulu la terminer dans ce bon et
modeste intérieur. Hélas! il ne devait pas en être ainsi.
Je ne rencontrai qu’une seule épreuve dans ce passage relativement
calme de ma destinée, et elle me fut absolument personnelle.
Un jour de mars, tandis que Mathilde et moi nous traversions la place
de la Comédie, un perfide et violent coup de vent, arrivant de la
Garonne, me retourna complètement. Je faillis être arraché des mains
de ma maîtresse et je me crus perdu; mais heureusement, 37 gardant
son sang-froid dans une pareille extrémité, cette femme de grand sens
eut l’idée ingénieuse de faire face au vent, qui, réparant lui-même
le mal qu’il avait fait, me remit dans ma position naturelle sans
autre dommage. C’est égal, je l’avais échappé belle et je frémis à ce
souvenir émouvant; je vois encore un chapeau, arraché à la tête qu’il
couvrait un instant auparavant, passant comme un boulet de canon à côté
de moi, et tous les papiers de la boutique d’une marchande de journaux
tourbillonnant ainsi qu’une troupe de gros pigeons échappés de leur
cage. Je dus mon salut à la présence d’esprit de ma propriétaire, et ce
trait m’attacha encore davantage à cette digne femme.
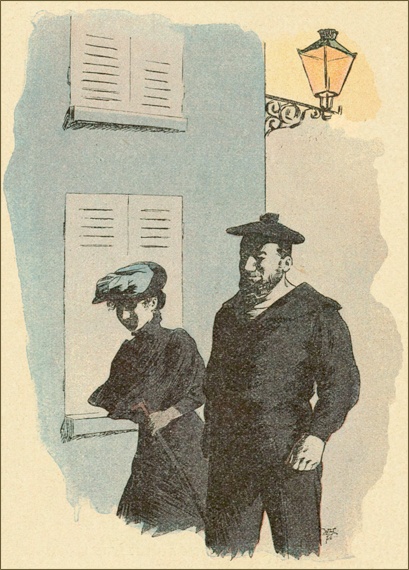
[↔]
LE MARIN ACCOMPAGNA MARIE.
Ce fut dans un jour de fête qu’eut lieu notre cruelle séparation, et
je ne doute pas qu’elle ait mêlé un deuil à la joie de mes chères
maîtresses.
M. Fabre, le patron du magasin de Mme Girard, avait résolu, dans une
pensée bienveillante et affectueuse, de donner une fête à ses ouvriers
et employés pour célébrer le cinquantième anniversaire de sa maison,
qui avait été fondée un demi-siècle auparavant par son propre père;
il désirait à la fois et rappeler la mémoire de ce père vénéré et
récompenser ceux qui l’avaient aidé à faire prospérer son œuvre.
Dans un restaurant de la banlieue de Bordeaux, pourvu d’un vaste
jardin, devaient se réunir au jour indiqué les ouvriers et ouvrières
des ateliers et les employés du magasin, pour un repas présidé par le
patron lui-même; à la suite du festin, des discours seraient prononcés,
puis, des médailles frappées pour la circonstance devaient être
décernées par M. Fabre aux plus méritants; enfin des divertissements
variés, ayant pour théâtre le jardin de l’établissement, terminaient le
programme de cette heureuse journée.
La fête, annoncée longtemps à l’avance, défraya la conversation d’un
grand nombre de veillées, aussi bien chez les ouvrières que chez leur
voisine Mlle Agathe, d’autant que (j’ai oublié de le mentionner) les
invitations s’étendant aux familles des ouvriers et employés, Mathilde
devait amener sa fille, et ce n’était pas une mince affaire que de
l’habiller pour la circonstance.
Les mères sont toujours un peu faibles quand il s’agit de parer
l’enfant chéri; 38 Mme Girard déclara la toilette des dimanches
insuffisante et Mlle Agathe, qui se faisait des idées grandioses sur
tout ce qui se rapporte au décorum, fut complètement de son avis.
A force de retourner dans tous les sens la question de la toilette de
l’enfant, les deux femmes résolurent ainsi le problème: Mlle Agathe
fournirait l’étoffe, un joli lainage blanc qui avait été jadis une robe
de chambre appartenant à une sœur du docteur Durand, et dont cette dame
s’était défaite en faveur de la femme de confiance de sa mère; Mathilde
avec ce tissu confectionnerait un costume simple mais soigné (les
modèles ne lui manqueraient pas), et elle se fit une joie de consacrer
ses soirées jusqu’à une heure avancée à ce travail agréable.
Le grand jour arrivé, on revêtit de la belle robe blanche la fillette
émue, troublée; Mlle Agathe déclara sans hésiter que Marie serait la
mieux habillée et la plus charmante de toute l’assemblée, et, sur cette
assurance encourageante, on partit.
Auparavant on avait longtemps discuté la question de savoir si on me
prendrait ou si on me laisserait à la maison; un parapluie n’est pas
un objet très élégant pour aller dans le monde, mais le temps menaçait
et c’eût été bien dommage de compromettre la jolie toilette blanche de
Marie. Mlle Agathe, avec son expérience, trancha la question:
«Emportez-le toujours, c’est plus prudent, et vous en serez quittes
pour le déposer au vestiaire.
—Vous avez raison, je ne pensais pas à la ressource du vestiaire;
allons, Marie, prends le parapluie!»
C’est ainsi que je me trouvai de la fête.
Nous dûmes d’abord monter en tramway, car l’établissement où l’on se
réunissait, situé hors de la ville, était à une fort grande distance;
enfin, après une longue course, nous atteignîmes notre but.
Que de monde! Jamais je ne m’étais trouvé en si nombreuse compagnie;
je me sentais presque intimidé au milieu de cette foule; nous étions
bien deux cents, au bas mot: jeunes, vieux, un peu mûrs, très mûrs
même, car, je dois l’avouer, la grande majorité des assistants étaient
d’un âge avancé; mais que le lecteur n’aille pas s’imaginer que je
parle de l’assemblée réunie dans la salle du festin, il s’agit bien
de ces employés en vérité! j’entends la société tout aussi nombreuse
et bien plus intéressante du vestiaire; là se pressaient, dans un
ordre parfait, une ficelle avec un numéro passé au col de chacun et
de chacune, des parapluies, des ombrelles, des cannes; il me fallait
remonter dans mes souvenirs d’enfance jusqu’au magasin de Mme Rossignol
pour me rappeler pareille réunion.
Cependant je me trouvais un peu perdu dans cette cohue, lorsque soudain
(ô joie inexprimable!) j’aperçus ma chère petite ombrelle bleue,
l’amie de mes premiers ans. Elle avait vieilli, moi aussi, évidemment,
néanmoins nous nous reconnûmes sans hésiter avec cet instinct du cœur
qui ne trompe point.
39
Notre rencontre fut touchante. La petite ombrelle bleue était ravie de
me revoir et m’étourdissait de ses questions.
«Ah! cher ami, qu’es-tu devenu depuis des siècles que nous ne nous
sommes vus? Parle vite, je t’en prie, avant que le destin barbare ne
nous sépare de nouveau!»
Je me hâtai de contenter son affectueuse curiosité, puis ce fut à mon
tour de lui demander par quel concours de circonstances j’avais le
bonheur de la retrouver.
Son existence se déroulait moins accidentée que la mienne; elle était
simplement passée des mains de la coquette et futile Antoinette
Rossignol dans celles d’une amie de cette dernière, Mlle Malvina,
préposée à la vente de la lingerie dans le magasin pour lequel
travaillait la mère de Marie.

[↔]
MARIE AVAIT REVÊTU SA ROBE BLANCHE.
«Alors, tu fus donnée en présent à cette demoiselle?
—Pas précisément; Antoinette, tu le sais, n’est guère généreuse: elle
m’a seulement troquée contre un éventail rose à paillettes d’or que
possédait son amie Malvina, et dont elle avait une envie folle.
—Ainsi tu as été la victime d’un caprice de cette frivole personne!
Quelle destinée est la nôtre! sans cesse vendus, volés, perdus, mis en
gage, jouets, en un mot, des humains!
—Il faut se résigner à son sort, dit doucement l’ombrelle bleue;
du reste, le mien n’a rien de particulièrement pénible. Ma nouvelle
maîtresse prend bien soin de moi et ne me sort que pour aller se
promener le dimanche, ou dans les grandes circonstances comme
aujourd’hui, seulement je ne vois plus jamais Antoinette, car les deux
amies se sont brouillées à la suite de l’échange fait entre elles:
Mlle Rossignol s’est sans doute avisée, mais trop tard, de la sottise
qu’elle a commise en changeant un objet utile comme une ombrelle contre
un accessoire de toilette mondaine; elle en a d’autant moins l’emploi
que, grâce à ses fantaisies ruineuses et à sa paresse, le magasin où
nous vîmes le jour ne tardera pas à être fermé, car ses propriétaires
font de très mauvaises affaires.»
Hélas! comme nous l’avions prévu, cet entretien entre mon amie
d’enfance et moi devait être trop court, et ici, alors qu’il nous
restait encore mille choses à dire, il fut 40 brusquement interrompu.
Les employés sortaient de la salle du festin et se répandaient dans
les jardins de l’établissement; or, comme la pluie menaçait, les plus
prévoyants vinrent reprendre d’avance leurs parapluies pour pouvoir
se garantir en cas d’averse. Mathilde fut du nombre et m’emporta dans
cette prévision, ne se doutant pas, la bonne âme, qu’elle m’imposait
une séparation cruelle; du reste, qu’aurait-elle pu y faire? les
destinées des parapluies et celle des ombrelles ne sont-elles pas
nécessairement séparées?
Je m’aperçus en revoyant Mme Girard qu’elle avait les yeux rouges
quoique son visage fût joyeux, contraste qui m’intrigua vivement
jusqu’au moment où une petite boîte en chagrin noir, qu’elle tenait à
la main, me révéla le mot de l’énigme.

[↔]
«SERRE-TOI CONTRE MOI, MA FILLE!»
«Ah! que je suis heureuse, Maman! Mais fais-moi donc voir ta belle
médaille!» disait Marie à sa mère.
Et l’écrin fut ouvert devant les yeux ravis de l’enfant. Il contenait
une médaille en vermeil, plus grosse qu’une pièce de cinq francs; d’un
côté, on y voyait écrits ces mots: «Travail et probité», de l’autre,
une inscription plus longue que je n’ai pu saisir; mais j’en savais
assez pour deviner que Mathilde avait été l’objet d’une distinction
flatteuse, cause de cette douce et profonde émotion.
La seconde partie de la fête commençait, et celle-là, spécialement
dédiée aux enfants: escarpolettes, jeux divers où les plus adroits,
les plus heureux gagnaient des macarons et des porcelaines variées,
légèrement ébréchées; mais décidément ce jour-là devait être celui des
rencontres et je n’en étais pas à ma dernière surprise.
Au centre du jardin, bien en évidence dans un endroit découvert, un
théâtre de Guignol se dressait avec sa toile rayée, tant soit peu
rapiécée, et son rideau d’un rouge éclatant; et non pas un Guignol
quelconque, mais mon Guignol, celui de la famille Louriguet; une figure
que je ne connaissais que trop, m’apparut soudain par la fente de côté
du petit théâtre, ne me laissa aucun doute: c’était celle de Fifine.
Sa vue ne me fit aucun plaisir, on ne peut en avoir à retrouver de
mauvaises connaissances, mais lorsqu’elle se montra tout à fait, quand
elle alla faire la quête, je remarquai sa robe de deuil et je pensai
que la douce colombe avait déployé ses ailes et quitté sa triste cage.
Ai-je besoin de dire que je veux parler de la touchante Mimi? Du reste,
je ne sus jamais si ma supposition était vraie; Fifine ne me reconnut
seulement pas et une pluie d’orage vint bientôt mettre fin et à la
représentation de Guignol et à toutes les joies de cette fête.
Ce fut alors un sauve-qui-peut général.
«Ah! que j’ai donc bien fait de prendre le parapluie, disait Mathilde.
Serre-toi bien contre moi, ma fille.»
41
Et je les abritais de mon mieux, flatté de voir rendre une justice si
éclatante à mes mérites. Hélas! les pauvres chères! je les abritais
pour la dernière fois.
Mais n’anticipons pas sur les événements.
VIII
JOURS D’ÉPREUVE
J’ai remarqué que les retours des parties de plaisir sont souvent
tristes; celui de la fête de M. Fabre devait être navrant. D’abord,
nous dûmes laisser passer quatre tramways sans trouver la moindre
place. Mais les ennuis de l’attente étaient peu de chose en comparaison
de la catastrophe qui se préparait.
Mme Girard et sa fille complétaient la voiture, qui regorgeait de
monde, car on s’empilait sur les deux plates-formes de l’avant et de
l’arrière. Juste à côté de Mathilde, qui m’avait déposé près d’elle,
se trouvait un jeune écolier d’une douzaine d’années, accompagné
d’un maigre et long personnage à lunettes que je supposai être son
précepteur, car je l’entendais dire à chaque instant: «Victor,
tenez-vous tranquille!» ce qui n’empêchait pas le petit garçon de
frétiller comme un poisson pris dans une nasse. A tout moment il se
levait, se mettait à genoux sur la banquette pour regarder au dehors,
puis, saisi du regret de ne plus voir le côté de la rue auquel il
tournait nécessairement le dos, il reprenait brusquement sa place,
le nez en l’air, la tête toujours en mouvement comme si elle se fût
trouvée non sur un cou humain, mais sur un pivot. Oh! le remuant petit
bonhomme! Dans ces incessantes évolutions, son malheureux parapluie
tomba trois fois. Que je le plaignais, cet infortuné confrère! et
j’ignorais encore à quel point il était digne de ma compassion.
A la troisième chute, le précepteur, agacé, finit par dire à Victor:
«Mettez donc votre parapluie près de vous.»
Victor obéit, parce que c’était un moyen de se débarrasser d’un objet
qui le gênait un peu pour se mouvoir, et le parapluie en question fut
posé précisément à côté de moi.
Hélas! fatal voisinage!
A ce moment, un heurt suivi de cris, de plaintes, d’un bruit de verre
cassé se fait sentir; une voiture de blanchisseuse, venant d’une
rue transversale et menée par une main féminine probablement très
inexpérimentée, prenait le tramway en travers, et le brancard de la
charrette pénétrait dans l’intérieur de la voiture en brisant une vitre.
On juge du tumulte et de la bousculade; tous les voyageurs du tramway
s’étaient levés précipitamment et se pressaient vers l’extrémité
ouverte de la voiture, désireux de descendre au plus vite. Quand je dis
tous, je me trompe: Victor avait trouvé plus simple, plus expéditif et
surtout plus pittoresque de s’évader par une fenêtre: passer par la
porte, c’est 42 trop vulgaire. Notre écolier, ravi de cette occasion
inespérée de développer ses talents gymnastiques (j’ai su depuis que
c’était le seul exercice où il fût toujours premier)! opérait sa
descente avec une incontestable supériorité, mais, malheur! trois fois
malheur, il ne l’exécutait pas seul, quoique son précepteur se fût bien
gardé de le suivre dans ce périlleux chemin; il m’entraînait avec lui,
me prenant pour son parapluie légitime, et laissait sa victime entre
les mains de Mme Girard qui, dans son trouble, ne se douta nullement de
la substitution.

[↔]
UN COUP DE VENT ME RETOURNA.
Il devait s’écouler un assez long temps avant que personne s’aperçût de
cette méprise. Le précepteur maigre avait éprouvé une peur affreuse,
d’abord au sujet de l’accident, ensuite devant l’escapade de son
élève, contre laquelle il avait protesté, et il fallut que cet homme
impressionnable se rendît chez un pharmacien et prît quelques gouttes
d’un cordial pour se remettre entièrement.
Après cela, le maître et l’élève firent plusieurs courses pour
lesquelles ils étaient sans doute venus à Bordeaux, puis, reprenant
le même tramway, mais dans un sens opposé, ils se rendirent dans une
belle propriété située moitié en ville, moitié à la campagne, dans les
environs des boulevards extérieurs, où les parents de Victor, M. et Mme
Larade, avaient leur résidence habituelle.
«Mais ce n’est pas ton parapluie!» s’écria Mlle Clotilde Larade en me
prenant, pour m’examiner de plus près, des mains de son frère. Et elle
ajouta: «Celui-ci est beaucoup moins neuf».
—Ma foi, il le sera toujours assez pour le régime auquel Victor met
ses parapluies!» fit remarquer M. Larade avec un sourire indulgent dont
je n’augurai rien de bon pour la tranquillité de mes vieux jours.
Ah! quel terrible gamin que ce jeune Victor! Dès le lendemain de mon
arrivée inopinée chez ses parents, il imagina de me faire subir un
véritable supplice.
Il venait justement de lire, dans l’Histoire de France, la fin tragique
de la reine Brunehaut, attachée à la queue d’un cheval indompté; c’en
était assez pour inspirer l’esprit inventif de Victor. Immédiatement
il charge Médor, le chien de chasse de son père, de 43 figurer le
cheval indompté, tandis que je dois représenter, lié par ses cordons
de souliers à la queue de l’animal, l’infortunée reine d’Austrasie.
Un coup de fouet appliqué sur son arrière-train fait partir Médor à
travers le jardin, et je semblais courir après lui, ce qui d’abord
l’effraya beaucoup.
Pendant ce supplice, notre bourreau riait à se tordre, trouvant sa
mauvaise plaisanterie la plus belle du monde. Sa joie fut assez
courte; Médor était un vieux chien assagi par l’âge et qui en avait
vu d’autres; il ralentit bientôt sa course, je m’accrochai à un
arbrisseau, et, à la suite d’une secousse qui faillit me rompre en
deux, il s’arrêta net.
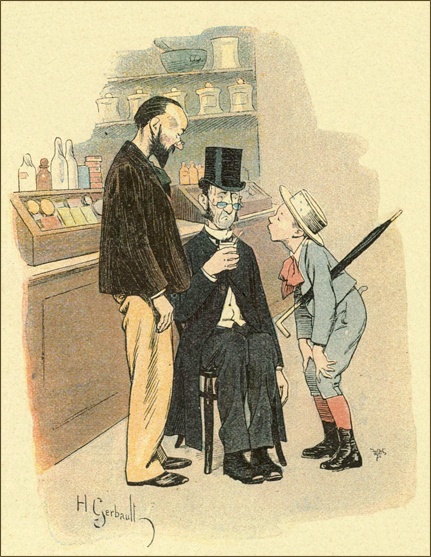
[↔]
LE PRÉCEPTEUR DUT PRENDRE UN CORDIAL.
J’étais sauvé. Le chien me flaira d’un air un peu inquiet, puis, après
quelques efforts inutiles pour amener une séparation entre nous, se
coucha paisiblement en rond à côté de moi et ne tarda pas à s’endormir.
Quelques instants plus tard, Victor vint couper la corde qui me
retenait à la queue de Médor.
Je touchais au terme de mes épreuves, mais par quelle terrible aventure
allait s’opérer ma délivrance!
Un jour, par ordre de son père, Victor fut privé d’un après-midi tout
entier de plaisir et consigné au logis, tandis que sa sœur Clotilde,
sous la conduite de Mme Larade, partait pour une charmante réunion
d’enfants, un goûter suivi d’une séance de prestidigitation avec
projections de lumière électrique et autres divertissements des plus
intéressants, chez leur grand’mère dont c’était précisément la fête.
En vain, la mère et la fille avaient supplié le père de famille de
faire grâce à Victor. M. Larade, quoiqu’il lui en coûtât certainement,
car bien souvent les parents souffrent plus des pénitences infligées
par eux à leurs enfants que ces chers petits coupables, M. Larade,
dis-je, fut inexorable.
Voilà donc notre Victor entièrement livré à lui-même. Il imagina alors,
pour se distraire, de s’amuser encore une fois à mes dépens.
Mon bourreau vint me chercher dans le porte-parapluie où j’étais placé,
me déposa dans un coin du vestibule et s’élança dans l’escalier,
qu’il gravit, comme d’habitude, par deux et trois marches à la fois.
Je l’entendis monter ainsi jusque dans les vastes greniers 44 qui
occupaient le haut de la maison, où le bruit de ses pas se perdit dans
l’éloignement. Il y resta environ vingt minutes, puis redescendit d’une
allure plus modérée qui me fit soupçonner qu’il rapportait des combles
un objet dont le transport nécessitait quelques précautions.
En effet, c’était un gros ballon peint de vives et brillantes couleurs,
représentant le ballon captif de la dernière Exposition. Je crois que
sa grand’mère lui avait fait cadeau de ce jouet au jour de l’an, alors
qu’heureux et paisible j’habitais encore la mansarde de la rue Grassi
avec Mathilde et sa charmante petite fille.
Le ballon, bientôt délaissé, était depuis longtemps relégué dans les
combles, mais voilà que le terrible enfant se souvenait soudain de son
existence. Que voulait-il donc en faire?
Fixant soigneusement l’aérostat en miniature à la rampe de la
véranda qui régnait devant la maison, afin que le vent ne l’enlevât
pas, il commença par décrocher la nacelle de zinc verni, remplie de
petits personnages fort bien imités, représentant les visiteurs de
l’Exposition, puis, me saisissant tout à coup, il m’attacha par un
bout de ficelle à la place de la nacelle, en disant avec un ricanement
féroce:
«Ce sera le parachute! Comme cela, le ballon aura tout ce qu’il lui
faut comme un véritable aérostat!»

BON VOYAGE, VILAIN PARAPLUIE!
Restait à savoir si le ballon devait demeurer dans son rôle de ballon
captif. Une seconde phrase, encore plus expressive que la première ne
me laissa guère de doute sur ses intentions:
«Bon voyage, vilain parapluie, et surtout point de retour!»
Tout en prononçant ces odieuses paroles, Victor défaisait le nœud assez
compliqué qui retenait solidement le ballon. Quand cette opération
fut terminée, je sentis avec effroi l’aérostat s’élever doucement,
m’entraîner après lui, et, une fois encore, la voix de Victor Larade
m’arriva distinctement:
«Ça marche, ça marche! Allons, le parapluie ne sera pas trop lourd
comme je le craignais!»
Nous avions dépassé le toit; un air plus vif nous saisissait, puis une
petite secousse se faisait sentir et le ballon s’élevait par une sorte
de bond dans le libre espace.
Victor avait coupé la corde!
Maintenant nous planions dans l’immensité, au-dessus de la ville de
Bordeaux qui ne m’apparaissait plus de la hauteur à laquelle nous
étions parvenus que tel qu’un grand amas de maisons séparées par de
petites raies blanches; sur ces raies se mouvaient, comme des fourmis,
les voitures et les humains.
45
Tandis que nous étions ainsi suspendus entre le ciel et l’eau,
voilà que mon compagnon forcé, l’aérostat, se met à descendre assez
rapidement; en même temps, saisi par des courants aériens qui règnent
au-dessus du fleuve, il tournoie sur lui-même; dans ce mouvement de
rotation, la ficelle mince à laquelle je suis suspendu s’use et bientôt
se rompt. C’en est fait, le soi-disant parachute s’est détaché du
ballon et tombe, en oscillant, d’une hauteur effrayante.
Si je tombais sur le sol, j’étais un parapluie perdu, brisé en mille
pièces, anéanti.... Je tombai dans le fleuve, à quelques mètres d’une
grosse gabare qui se laissait tranquillement aller au fil de l’eau.
«Eh! petit, qu’est-ce que c’est que ce poisson-là? s’écria une voix
enrouée.
—C’est un parapluie, patron, répondit le jeune garçon ainsi interpellé.
—Eh bien, prends le canot, et va-t’en me pêcher ce marsouin-là!»
Avec une rapidité de singe, l’enfant détacha le petit esquif qui se
balançait à l’arrière de la gabare, descendit dedans et, tout en
godillant, c’est-à-dire en ramant avec un seul aviron placé à l’arrière
de son batelet, s’approcha de moi; il était temps, je coulais,
m’enfonçant déjà à demi; mais bientôt il me saisit, et me mit tout
ruisselant dans le canot.
«C’est un parapluie encore très bon, s’écria le patron en me recevant
des mains du mousse. Sais-tu ce que je veux en faire, petit?
—Peut-être que vous voulez m’en faire cadeau, hasarda le jeune
intrigant.
—As-tu fini! Te donner ce beau parapluie, à toi? Les enfants, ça ne
se connaît plus au jour d’aujourd’hui; d’ailleurs un marin ne doit pas
craindre l’eau, et, en conséquence, se servir de parapluie.
—Alors, patron, que voulez-vous en faire?
—Je veux le porter à ma promise, Mlle Irma; elle m’avait justement
demandé des pendants d’oreilles en corail.
—C’est que c’est pas la même chose, fit remarquer judicieusement le
mousse.
—Ça ne fait rien, ça passera comme cela!» conclut péremptoirement le
gabarier.
Charmé par cette idée qu’il pourrait offrir un cadeau à sa fiancée sans
bourse délier, il se mit en devoir «de me parer» de son mieux. Avec un
tampon d’étoupe, il enlève les taches de vase qui souillaient ma robe
et fait reluire le métal dont mon manche est surmonté, puis il me place
sur l’avant du bateau bien exposé au soleil, et déclare que j’ai l’air
tout neuf, ce à quoi le mousse ne contredit point, grâce à la crainte
salutaire que peut produire un bout d’amarre transformé en moyen de
coercition.
Quand nous eûmes débarqué un chargement de barriques neuves, que
portait la gabare, mon nouveau maître laissa son bateau à la garde du
mousse, et, après avoir fait un brin de toilette, se rendit chez sa
promise.
Il n’eut pas à aller loin, car Mlle Irma était servante dans un hôtel
avoisinant le port.
«Mademoiselle, dit-il en prenant son air le plus aimable, je vous
apporte quelque 46 chose pour vous faire plaisir, car je me suis
laissé dire que les petits cadeaux entretiennent l’amitié.
—Mes boucles d’oreilles! s’écria la jeune personne en rougissant de
joie devant cette entrée en matière si engageante.
—Pas tout à fait; j’ai pensé que quand on se mettait en ménage, il
fallait songer au sérieux.
—Ah! dit seulement Mlle Irma, subitement attristée et prévoyant une
déception.
—Je vous apporte un joli parapluie à la dernière mode de Paris!»

[↔]
«VOICI UN JOLI PARAPLUIE!»
Il avait affaire à forte partie, et, sans donner dans la réclame, on
m’examina d’un œil soupçonneux; le résultat de cet examen fut une moue
épouvantable, suivie d’une grimace larmoyante qui n’embellit pas le
visage de Mlle Irma.
«Eh bien! qu’est-ce qu’il y a? demanda le marin.
—Il y a que vous avez voulu me tromper en me donnant un vilain
parapluie d’occasion et que c’est un affront que je ne vous pardonnerai
jamais!»
Je crois qu’au fond elle lui en voulait surtout à cause des boucles
d’oreilles qu’il ne lui avait pas apportées, mais la querelle
s’envenima sur ma triste personnalité et les deux fiancés se séparèrent
presque brouillés à cause de moi.
Il était écrit que je devais toujours être victime de l’injustice des
hommes; comme Victor, le gabarier s’en prenait à moi de son mécompte,
et rien qu’à la manière dont il me tenait du bout des doigts, je
sentais qu’il m’en voulait mortellement.
Absorbé dans les tristes pensées que lui inspirait sa récente querelle
avec sa promise, il vint s’accouder au parapet du grand pont qui fait
communiquer les deux rives de la Garonne à Bordeaux.
«Ah! se disait-il, j’ai fait du bel ouvrage avec ce parapluie!
Il aurait mieux valu le laisser aller au fil de l’eau que m’en
embarrasser. Aussi cette Irma n’est guère raisonnable et aime
terriblement les bijoux. Oh! scélérat de riflard, j’ai envie de te
jeter à l’eau pour ne plus t’avoir devant les yeux!»
Comme notre marin avait la mauvaise habitude de parler tout haut, à cet
endroit précis de son monologue, une voix jeune s’élève soudain à côté
de lui:
47
«Donnez-le-moi plutôt, mon bon Monsieur!»
Et, se retournant aussitôt, mon propriétaire aperçoit un garçon de
quinze ans environ, pâle et maigre, mais l’air intelligent et doux,
qui s’appuyait, lui aussi, au parapet de pierre, tandis qu’une boîte à
cirage était posée à ses pieds.
Il y a des figures sympathiques: celle du jeune garçon plut au
gabarier, et après un petit moment de réflexion il murmura en me
tendant au gamin:
«Je veux bien, si ça te fait plaisir; tiens, prends-le, mon garçon, je
souhaite qu’il te porte bonheur plus qu’à moi!»
Sans se laisser impressionner par ces paroles peu rassurantes,
l’adolescent me reçut avec un mouvement de joie, remercia rapidement
son bienfaiteur inconnu, puis s’en alla au plus vite du côté de La
Bastide, faubourg de Bordeaux situé à l’extrémité du pont, comme s’il
eût craint de voir le marin se raviser et reprendre son bien.
«Maman, Maman, voyez quelle chance j’aie eue! Ce parapluie, ce beau
parapluie presque neuf qu’un monsieur m’a donné.
—Quel monsieur? Quel parapluie? demanda en souriant une personne
encore plus pâle, encore plus maigre que le jeune garçon, qui était
occupée à faire des fleurs artificielles près de la fenêtre d’une
pauvre chambre à peine meublée, dans laquelle mon nouveau maître venait
de pénétrer. Voyons, Maurice, que veux-tu dire? Assieds-toi là, auprès
de moi, et explique-toi.»
L’enfant raconta sa petite aventure et comment il avait guetté le
gabarier, croyant d’abord qu’il songeait à se jeter lui-même dans la
Garonne, supposition qui aurait fort étonné le brave homme, lequel,
avec ou sans Mlle Irma, comptait bien remplir toute sa carrière en ce
monde.
Cependant la mère semblait moins enthousiaste que le fils de la bonne
aubaine.
«J’aurais mieux aimé que cet homme t’eût donné une pièce de quarante
sous, dit-elle en hochant tristement la tête; enfin il faut accepter ce
que la Providence nous envoie.»
Mais l’enfant, les yeux brillants:
«Qui sait, Maman, si je ne gagnerai pas plus de quarante sous avec ce
parapluie-là? Vous verrez; il me vient toutes sortes d’idées à son
sujet.
48
—A merveille, mon ami, seulement laisse-moi travailler, car je crains
fort que tes idées ne nous donnent pas ce qu’il faut pour payer le
boulanger.»
Et elle se remit fiévreusement à sa tâche pendant que son fils
méditait, les yeux fixés sur moi.

[↔]
L’ENFANT COMPTAIT SA RECETTE.
Chez Mme Lefranc (ainsi se nommait la mère de Maurice) ce n’était plus
la pauvreté presque aisée de Mathilde et de sa fille, mais la vraie
misère quoique la mère et le fils luttassent avec courage contre elle.
On ne gagnait pas suffisamment dans cette pauvre demeure, parce que
la maladie y élisait trop souvent domicile avec les frais de médecin
et le chômage forcé qu’elle entraîne avec elle. Maurice avait eu une
enfance délicate, et maintenant qu’il paraissait prendre le dessus,
c’était sa mère qui se trouvait sans cesse malade. Quant au père de
famille, couvreur de son état, il y avait plusieurs années qu’un de
ces accidents trop fréquents dans ce dangereux métier l’enlevait pour
toujours aux siens.
Maurice était un garçon d’imagination; pas très fort, inhabile à tout
travail sérieux, parce que sa délicatesse de santé et le manque de
ressources l’avaient empêché d’apprendre une profession, mais, actif
et intelligent, il s’ingéniait de mille façons pour venir en aide à sa
mère en gagnant quelques sous.
Dans le jour, il cirait les chaussures à l’extrémité du pont de
Bordeaux où nous avions fait connaissance; le soir, à la porte des
théâtres ou à l’arrivée des trains aux gares de chemin de fer, il
allait chercher des voitures, portait de menus paquets, faisait les
commissions. Maintenant qu’il possédait un parapluie, il songeait aussi
à en tirer profit dans son petit commerce nocturne: il pouvait l’ouvrir
sur la tête des gens qui montaient ou descendaient de voiture, ce qui
lui donnait droit à un plus fort pourboire; s’il s’agissait de simples
piétons, ayant une courte distance à franchir, il leur offrait l’abri
de son parapluie ou le leur abandonnait pendant qu’il courait sous
l’averse chercher le véhicule demandé, et ainsi se multipliaient les
gratifications, et la pauvre mère souriait au retour en comptant la
recette, tandis que l’enfant murmurait joyeusement:
«Maman, c’est le parapluie, le parapluie que vous avez si mal reçu qui
nous vaut tout cela!»
J’étais fier de me sentir utile et d’être devenu, dans les mains de
l’intelligent petit bonhomme, un instrument de travail; malheureusement
je ne devais pas longtemps y rester; rien d’instable, hélas! comme la
destinée d’un parapluie.
Un soir, comme il y avait représentation au Grand-Théâtre, Maurice
vaguait sur la place de la Comédie, en quête de bonnes occasions. Il
aperçut un monsieur arrêté, immobile sur le trottoir et regardant
vaguement devant lui. C’était un homme déjà un peu âgé, l’air très
respectable, avec des cheveux blancs assez longs qui s’échappaient de
dessous son chapeau.

[↔]
«PRENEZ MON PARAPLUIE, MONSIEUR!»
«Monsieur, lui dit Maurice, il va pleuvoir, bien sûr; voulez-vous que
j’aille vous chercher une voiture?»
Le vieux monsieur sourit sans répondre, comme s’il était absorbé par
une pensée intime, mais ce sourire parut un signe d’acquiescement
suffisant à notre jeune garçon qui n’avait pu gagner un sou ce soir-là.
«Prenez mon parapluie, Monsieur, car il pourrait tomber de l’eau avant
que je revienne, et ne vous ennuyez pas après moi si je suis un bout de
temps; il y a grand bal à la Préfecture et les voitures se font rares.»
En terminant cette phrase, que le vieux monsieur n’avait certainement
pas écoutée, car il regardait toujours machinalement devant lui sans
s’occuper de ce gamin inconnu, en terminant cette phrase, dis-je,
Maurice me mit dans la main de son client et s’élança à la recherche
d’un fiacre.
Il avait à peine disparu que le respectable vieillard, se réveillant
comme d’un rêve en sentant tomber sur lui de grosses gouttes de pluie,
m’ouvrit tranquillement et s’éloigna à petits pas de la place de la
Comédie. Étais-je tombé dans les filets d’un adroit escroc s’en prenant
même aux pauvres pour les dépouiller? Je frémis d’horreur à cette
supposition.
En tout cas, ce malfaiteur n’habitait pas un quartier mal famé,
puisque ce fut à l’Hôtel de France, là où descendent tous les grands
personnages de passage à Bordeaux, qu’il me conduisit directement; il
semblait même un habitué de cet hôtel, car le garçon l’appela 50 par
son nom: M. Dufour, en lui offrant sa clef et son bougeoir pour monter
dans sa chambre.
Le lendemain, de bon matin, nous partions, M. Dufour et moi, pour
Ruffec, ville natale de mon ravisseur. Le garçon d’hôtel, fort empressé
envers son client, l’avait aidé à faire ses paquets et notamment me
ficelait avec un autre parapluie, une ombrelle et une canne, le tout
formant un gros faisceau recouvert d’un étui de toile cirée, dans
lequel nous étions bien à l’étroit. M. Dufour, toujours un peu absorbé,
mais n’offrant pas la plus petite apparence de remords, me coucha
tranquillement dans le filet de son compartiment de chemin de fer.
«Quelle conscience endurcie! me dis-je. Voler un pauvre enfant avec
cette tête de patriarche, c’est affreux!»
Et je songeais avec un véritable chagrin à la douleur de mon jeune
maître perdant son gagne-pain, rentrant sans lui et racontant sa
mésaventure à sa mère.
Sur le quai de la gare, nous trouvâmes la gouvernante de M. Dufour,
Mlle Prudence, une vieille fille à la figure tant soit peu grognon.
«Bonjour, Prudence, lui dit gracieusement son maître; vous avez eu une
bonne idée de venir au-devant de moi.
—C’est plus sûr, dit-elle sentencieusement en hochant la tête d’une
manière expressive. Voyons, Monsieur, faites bien attention; passez-moi
tous vos colis.»
M. Dufour obéit docilement, et, à mesure qu’il lui tendait les objets,
elle énumérait à demi-voix:
«La valise, bon; votre couverture de voyage, maintenant? Votre carton à
chapeau? Et puis?...
—Tout y est!» s’écria triomphalement M. Dufour.
Mais la sage Prudence, bien digne du nom qu’elle portait, ne se fiant
pas à cette assertion quelque peu hasardée, monta dans le wagon et nous
découvrit dans le filet.
«J’étais certaine que vous oublieriez quelque chose; vous n’en faites
jamais d’autres!» murmura la bonne.
M. Dufour, escorté de sa servante, atteignit bientôt une petite maison
proprette, toute blanche avec des volets verts, qui exposait sa modeste
façade en plein midi, dans une rue large et tranquille, où l’herbe se
montrait entre les pavés.
Les bagages de M. Dufour furent déposés dans sa chambre, et, après
une courte conversation entre lui et sa gouvernante sur son voyage
(il était allé voir une de ses filles mariée à Bordeaux), sur ce qui
s’était passé pendant son absence à Ruffec, ce dernier chapitre traité
très brièvement par la vieille fille, qui était peu loquace, celle-ci
s’écria:
«Maintenant, Monsieur, il faut que je déballe vos affaires.
—A merveille, ma bonne; vous verrez comme cette fois j’ai fait
attention à tout! Vous m’adresserez des compliments!»
51
Et il s’assit dans un grand fauteuil, l’air très satisfait de lui.
Des compliments! Il croyait avoir mérité des compliments! C’est-à-dire
que Prudence ne lui répondit que par des gémissements et par des cris
d’horreur.
«Où sont vos gilets de flanelle tout neufs?
—Je ne sais pas, Prudence.

[↔]
«PASSEZ-MOI VOS COLIS, MONSIEUR!»
—En voici bien un, mais il est reprisé et de quelle manière! Je vous
ai mis une douzaine de mouchoirs et il n’en reste plus que trois!
—Êtes-vous sûre de votre compte?
—Parfaitement; la douzaine y était. Et votre peigne d’écaille?
—Eh bien!
—Eh bien! il est en corne maintenant!
—Pas possible!
—Et cette veste de chasse?
—Ah! cette veste de chasse pourrait bien être à mon gendre; je ne sais
vraiment pas comment elle s’est fourrée dans mes affaires.
—Il est probable qu’elle ne s’y est pas mise toute seule.
—Probable, en effet, Prudence.
—Ah! vos distractions! Monsieur, toujours vos distractions! c’est une
maladie d’être comme ça.
—Alors il ne faut pas m’en vouloir», fit remarquer M. Dufour avec une
douceur touchante qui ne désarma cependant pas la gouvernante.
Ayant terminé avec la valise, elle nous déficelait, mes compagnons et
moi.
«Voilà une belle histoire, à présent!
—Est-ce que j’aurais oublié mon parapluie? demanda son maître un peu
inquiet.
—Bien au contraire: vous en avez deux!
—Deux parapluies?
—Est-ce que vous en auriez acheté un pour le cas où vous perdriez le
vôtre, ce qui vous arrive souvent?
52
—Nullement. Je n’ai rien acheté.
—On vous en a fait cadeau, peut-être?
—Point du tout!
—Alors il faut que vous l’ayez volé, Monsieur!
—Vous croyez rire, Prudence, et c’est pourtant la pure vérité; je l’ai
volé, volé à un pauvre enfant qui me l’avait prêté pendant qu’il allait
me chercher une voiture!»

[↔]
«CE PARAPLUIE N’EST PAS A VOUS.»
Et soudain toute la petite scène qui s’était passée entre lui et
Maurice, sur la place de la Comédie, se déroula comme une vision très
nette, très distincte, dans l’esprit subitement éclairé de M. Dufour.
«C’est affreux!» conclut-il en prenant sa tête blanche à deux mains.
Décidément ce n’était pas un scélérat, mais simplement un homme
distrait. Je dus même reconnaître que M. Dufour avait, au contraire,
un excellent cœur quand je l’entendis se lamenter si sincèrement à
mon sujet, reconnaissant ou inventant toutes les circonstances qui
pouvaient augmenter son repentir.
«Je n’ai fait que l’entrevoir sous le bec de gaz, murmurait-il désolé
en pensant à Maurice; il me serait impossible de dire quelle est sa
figure, mais je me souviens d’une mince blouse de toile bleue sur un
corps grêle d’adolescent; cette blouse par un temps froid dénotait bien
la misère, et cette maigreur, une vie de privations.... Le pire de
ma situation, c’est l’impossibilité de réparer mes torts! Mais cette
impossibilité est-elle absolue, complète? Je tenterai au moins tout ce
qui dépendra de moi pour lui restituer son parapluie.»
M. Dufour écrivit à Bordeaux et fit des démarches pour retrouver
sa victime; les suites de sa distraction lui étaient d’autant plus
pénibles, qu’affilié à plusieurs œuvres de charité, il connaissait les
dures conditions de la vie du pauvre et savait que le moindre objet
faisant défaut dans son misérable intérieur constitue une perte souvent
irréparable pour lui.
Enfin, n’y tenant plus, il dit un matin à sa gouvernante, sur un ton
décidé qui ne lui était pas habituel:
«Prudence, je pars pour Bordeaux; faites ma valise, et mettez-y le
moins de choses possible.
—Monsieur n’a pas besoin de me recommander cela», grogna l’irascible
vieille fille.
Il se garda bien de m’oublier, car quoiqu’il eût prétexté une visite
à sa fille, c’était en réalité à cause de moi qu’il entreprenait ce
voyage.
53
X
OU LE BRAVE HOMME ET LE BRAVE ENFANT SE RENCONTRENT
Nous arrivâmes sans encombre. M. Dufour se surveillait beaucoup,
résistant héroïquement aux entraînements perfides de la distraction.
A peine installé chez sa fille, Mme Mancel, sans s’attarder aux joies
de cette réunion de famille, il commença secrètement ses démarches de
restitution, s’adressant d’abord à la police. Mais la police, tout
à fait inaccessible à ses troubles de conscience et trouvant ses
indications insuffisantes, ne donna aucune attention à son affaire, et,
en conséquence, ne lui fournit pas le moindre renseignement. Alors M.
Dufour, comprenant qu’il ne pouvait compter que sur lui-même, entreprit
quelques recherches personnelles aux environs du Grand-Théâtre.
Une fois qu’il rôdait sur la place de la Comédie, il aperçut un
jeune garçon entre quinze et seize ans qui arrivait par la rue du
Chapeau-Rouge, sifflotant une petite chanson, le nez en l’air, les
mains dans ses poches.
«Si c’était lui!» pensa M. Dufour en le suivant tout doucement.
Et il ajouta:
«Il me semble que le mien était plus mince et plus petit, mais, en
trois mois, à cet âge de transition, on peut se fortifier.»
S’encourageant ainsi, malgré les doutes que faisaient naître en lui la
tournure et l’aspect du gamin, il se décida à l’aborder après quelque
hésitation.
«Mon enfant, lui dit-il à brûle-pourpoint, est-ce que vous avez un
parapluie?»
Le gamin le regarde d’abord effaré, puis, sa physionomie se
transformant aussitôt, il lui répond:
«Je ne me paye pas le luxe d’un riflard; mais si c’est votre idée de
m’en donner un, faut pas vous gêner, mon bourgeois.»
M. Dufour murmura tout penaud:
«Pardon, je me suis trompé.»
Et il se hâta de se dérober au persiflage qu’il avait imprudemment
provoqué.
D’un regard moqueur et curieux, le jeune garçon le poursuivit un
instant, puis, abordant un sergent de ville, il lui dit d’un air
important:
«Tenez, Sergent, vous voyez ce particulier-là qui s’en va du côté de
Tourny: eh bien, il a une araignée dans le plafond.
—En tout cas il ne doit pas être dangereux avec cette tête-là; allons,
laisse-moi tranquille, moutard. Mêle-toi de ce qui te regarde.»
54
M. Dufour avait conscience qu’il s’était montré sous un jour un
peu étrange, et, possédant un caractère fort timide, cette petite
mésaventure le rendit plus circonspect; mais il ne renonçait pas pour
cela à ses recherches.
En achetant le Petit Journal dans un kiosque situé près du
théâtre, il eut l’idée d’interroger la vieille marchande sur le sujet
qui lui tenait tant au cœur. Cette femme, naturellement bavarde,
engagea volontiers la conversation.

[↔]
«CE MONSIEUR DOIT ÊTRE FOU.»
«Attendez, dit-elle, un petit gamin d’une quinzaine d’années, l’air pas
bien fort, mais dégourdi, je connais cela.
—Vous le connaissez? s’écria avec joie M. Dufour.
—Je crois, du moins, et il n’y a pas à s’étonner: la place de la
Comédie, c’est comme qui dirait mon pays.
—Alors ce garçon...?
—C’est un bon petit enfant qui reste en La Bastide, de l’autre côté du
pont; dans le jour il cire les chaussures.
—C’est possible.
—Le soir, il ouvre les portières des voitures devant le théâtre ou
fait les commissions des personnes qui sont à la représentation.
—A merveille!
—Mais qu’est-ce que vous lui voulez? Est-ce pour un héritage? Il en
aurait besoin, le pauvre!» s’écria la marchande, curieuse à son tour et
légèrement soupçonneuse.
M. Dufour fut fortement tenté d’inventer une histoire quelconque
pour expliquer sa conduite, car il était assez honteux de son excès
de distraction, néanmoins il se dit qu’il ne fallait pas ajouter un
mensonge à ses autres fautes, et, avec une candeur touchante, raconta
toute son aventure à la marchande de journaux, qui, flattée et émue de
la confiance qu’elle inspirait, s’écria:
«Vous êtes un brave homme de vous mettre en peine de cet enfant;
repassez demain et je vous donnerai encore quelques renseignements à
son sujet; je ne connais ni son nom ni son adresse, mais, tout de même,
celui dont je vous parle doit bien être le vôtre.»
Là-dessus on se sépara et la marchande, comme elle l’avait promis, se
livra à un supplément d’enquête.
Cependant, malgré tout son zèle, lorsque M. Dufour arriva le lendemain,
fidèle au rendez-vous, elle ne put lui indiquer le domicile de l’enfant
ni son nom, quoiqu’elle eût 55 appris bien des choses sur son
compte, entre autres la triste cause de son absence du péristyle du
Grand-Théâtre depuis déjà bon nombre de jours.
«Serait-il malade?
—Non, c’est sa mère qui est morte hier matin.
—Vous êtes sûre?
—C’est le pauvre petit qui l’a dit lui-même à un commissionnaire, sur
le pont.
—Son adresse, son adresse?
—Je ne l’ai pas, Monsieur. Mais j’y pense! vous avez un moyen de le
trouver: il paraît que l’enterrement de sa défunte maman se fera à huit
heures à leur paroisse: allez-vous-en vers les neuf heures au cimetière
de la Chartreuse, et vous aurez bien de la malchance si vous ne le
trouvez pas.
—Mais dans cette foule?
—Il n’y aura pas foule, vous pouvez être tranquille; la mère et le
fils vivaient très isolés et étaient nouvellement installés dans leur
quartier.
—Merci, Madame, de votre obligeance: je suivrai votre excellent
conseil.
—Eh! Monsieur, Monsieur! et mon sou pour le Petit Journal?»
M. Dufour, décidément incorrigible dans sa distraction, s’éloignait
sans payer son achat quotidien!
Neuf heures sonnaient à l’église Saint-Bruno, la paroisse du lieu
funèbre, lorsque M. Dufour, me tenant dans sa main, franchit les
grilles du vaste champ de repos de la ville de Bordeaux. Il s’assit non
loin d’un monument élevé à la glorieuse mémoire de nos soldats morts
pendant la guerre de 1870 et attendit, les yeux fixés sur la principale
entrée.
D’abord il vit défiler le convoi d’un petit enfant, puis celui d’une
personne riche: rien là qui pût l’intéresser, sinon par cette pitié que
la douleur, même des inconnus, ne peut manquer d’éveiller dans un bon
cœur.
Maintenant un modeste convoi, l’enterrement du pauvre dans toute sa
simplicité, se présente à sa vue. Derrière le cercueil, seulement deux
personnes, deux en tout: une vieille femme qui a mis un fichu noir sur
sa tête pour la circonstance, mais qui, évidemment, n’est pas en deuil,
et un jeune garçon d’une quinzaine d’années qui sanglote, le visage
caché dans un mouchoir de couleur. Quoiqu’il ait une veste noire au
lieu de sa blouse 56 bleue, M. Dufour s’écrie: «Ce doit être lui!»
Et, ému, intéressé, il suit de loin l’humble cortège et va se poster
derrière un monument, tout près de la tombe béante.
La dernière et douloureuse cérémonie fut bientôt terminée; alors la
femme, frappant doucement sur l’épaule de l’enfant toujours agenouillé,
lui dit d’un ton affectueux mais décidé:
«Allons, mon pauvre petit, il faut nous en retourner!
—Ah! Madame Michaud, la laisser seule ici!
—Elle sera pas seule; il y a plus de monde sous terre que dessus,
mets-toi cela dans l’idée.»
Mais cette pensée philosophique ne parut pas consoler du tout l’enfant.
«Dis encore un bout de prière, et puis partons.
—Partez, Madame Michaud, et merci de votre complaisance pour m’avoir
fait la conduite; mais j’aime mieux rester encore un peu près de maman.
—Comme tu voudras, si ça doit te soulager; tu es assez grand pour
trouver ton chemin; mais après viens tout droit chez nous, je te
garderai quelque chose à manger. Entre voisins faut s’aider; on n’est
pas des sauvages. A tantôt, Maurice!»
La mère Michaud, que ses occupations appelaient sans doute
impérieusement, s’éloigna là-dessus à grands pas; alors le jeune garçon
pleura de nouveau, pria, baisa la terre fraîchement remuée, puis, un
peu calmé, se mit à réfléchir tristement.
M. Dufour, qui avait attendu, respectant cette grande douleur, pensa
que le moment était venu d’aborder enfin Maurice.
«Mon enfant, lui dit-il avec bienveillance, je vois que vous avez bien
du chagrin.»
Maurice, un peu saisi à la vue de cet inconnu, ne répondit pas tout de
suite, mais, remarquant son air attendri, il s’écria:
«Oh oui! Monsieur, songez donc! c’est maman, ma pauvre maman qu’ils ont
mise là!
—Je vous plains beaucoup!»
L’accent était si profondément compatissant que l’enfant prit
immédiatement confiance dans cet étranger, et il continua, épanchant
son cœur trop plein:
«Papa est mort depuis longtemps; je n’avais plus que ma mère, et
maintenant je n’ai 57 plus rien, pas même un souvenir du temps où
nous étions heureux ensemble, car le logeur nous a tout saisi.
—Comment, tout saisi?
—Oh! c’était son droit, nous lui devions deux termes, alors il s’est
payé comme ça, cet homme; mais j’aurais bien aimé avoir quelques
petites choses dont maman se servait d’habitude.
—Eh bien, vous me mènerez chez ce logeur et je lui rachèterai ce que
vous voudrez.
—Vous ferez cela, Monsieur?
—Certainement; ce sera une réparation pour le préjudice involontaire
que je vous ai causé.»
L’enfant le regardait étonné. Alors, me tirant de derrière lui, où il
m’avait jusque-là tenu masqué:
«Est-ce que ce parapluie ne vous rappelle rien?»
Maurice, oubliant un instant son chagrin, me contempla attentivement.
«Mais c’est le mien, qu’un vieux monsieur m’a pris sur la Place de la
Comédie!
—Eh bien, ce vieux monsieur, c’était moi, dit humblement M. Dufour;
mais je n’avais pas l’intention de vous le dérober, mon enfant, je n’ai
jamais de ma vie commis d’action aussi blâmable. Seulement je suis la
proie d’une terrible infirmité qu’on nomme distraction; c’est ainsi
qu’en pensant à autre chose je me suis éloigné ce soir-là, oubliant que
vous étiez allé me chercher une voiture et emportant votre parapluie;
le lendemain, je quittais Bordeaux sans m’apercevoir de la présence
de ce parapluie étranger parmi mes bagages, et il a fallu que ma
gouvernante le découvrît pour que je comprisse mon erreur. Alors j’ai
écrit à Bordeaux, je me suis remué mais en vain jusqu’au jour, bien
triste, où je vous ai retrouvé, par un concours de circonstances, j’ose
le dire, providentiel. Tenez, commencez par reprendre votre bien, car
je serais capable de l’emporter encore sans y penser.»
A ma profonde stupéfaction, Maurice me repoussa.
«Gardez-le, Monsieur; ce parapluie-là ne me rappelle rien de bon, c’est
le jour où je l’ai perdu que ma chère maman a eu son attaque, qu’en
rentrant je l’ai trouvée à moitié morte.
—A moi non plus il ne me rappelle rien de bien agréable, car ce
stupide objet m’a causé de pénibles troubles de conscience.»
Encore une fois j’étais en butte à l’injustice des hommes, qui
faisaient retomber sur moi leurs propres erreurs ou les malheurs de
l’existence humaine. Voyez un peu l’ingratitude de ce petit Maurice!
N’aurait-il pas dû, au lieu de me dédaigner, me mettre en une place
d’honneur, comme un talisman précieux?
A partir du jour où M. Dufour voulut me restituer à cet adolescent,
il le prit en affection, s’intéressa à son avenir et, non content de
lui avoir donné des secours immédiats, 58 résolut de l’arracher à
l’abandon et à la misère, si dangereux à son âge, dans lesquels le
laissait la mort de sa mère.
Se souvenant que Prudence se plaignait toujours d’avoir trop d’ouvrage,
il forma le projet de la soulager en prenant Maurice à son service.
Comme c’était un homme raisonnable, il commença par se livrer à une
petite enquête au sujet du jeune garçon. La voisine Mme Michaud, le
commissionnaire du pont, successivement interrogés par lui, furent
unanimes dans leurs éloges: «Maurice était un bon petit garçon, d’une
santé assez délicate, mais ne boudant point l’ouvrage et d’un bon
caractère».
Ainsi rassuré sur les antécédents de son protégé, M. Dufour fit venir
l’enfant chez lui et, avec une bienveillance marquée, lui offrit
d’entrer à son service. Oublié dans un coin, j’assistai à l’entrevue.
Maurice d’abord resta sans parole; la joie l’étouffait.
«Est-ce que ça ne te va pas? demanda M. Dufour, qui déjà prenait
possession de son petit serviteur par un affectueux tutoiement.
—Bien au contraire, Monsieur; il me semble avoir gagné le gros lot à
la loterie.
—Si tu te comportes bien, j’espère en effet que ce sera un peu comme
si tu avais gagné une bonne prime.
—Ah! Monsieur, je vous servirai de mon mieux. Vous serez content de
moi!
—Me contenter ne sera peut-être pas le plus difficile, dit M. Dufour
en souriant, mais il faudra tâcher de plaire à Prudence, ce qui est
moins aisé.»
L’accord entre le nouveau serviteur et son maître fut conclu la veille
même du départ de M. Dufour pour Ruffec, et le lendemain ils montaient
ensemble dans l’express de Paris, m’oubliant dans mon coin, cette fois,
je le soupçonne, assez volontairement.
J’y restai quelques jours dans un parfait abandon, mais une parente de
la fille de M. Dufour, ayant annoncé son arrivée, on prépara de nouveau
la chambre d’ami et Mme Mancel, qui était une maîtresse de maison
attentive, vint y jeter un coup d’œil pour s’assurer que tout était en
ordre.
«Qu’est-ce que c’est que ce parapluie-là? demanda-t-elle à sa femme de
chambre.
—C’est le parapluie de M. Dufour, qui l’a oublié à son dernier voyage.
—Peut-être mon père n’en veut-il plus, car il est vieux et démodé;
je me souviens même que nous en avons acheté un ensemble dans la rue
Sainte-Catherine, sans doute pour le remplacer. Quoi qu’il en soit, il
ne doit pas rester là. Vous le monterez 59 au grenier, et vous le
placerez dans la partie consacrée aux choses de rebut.»
Mon arrêt était prononcé: j’étais mis à la retraite.
XI
DANS LES COMBLES
Sous le toit de la maison de Mme Mancel existaient de vastes greniers,
fort bien aménagés, qui servaient de réserve et de débarras aux autres
étages de la maison; là s’entassaient les coffres de voyage, les vieux
meubles, mille objets encombrants, non pas en désordre, mais classés
méthodiquement.
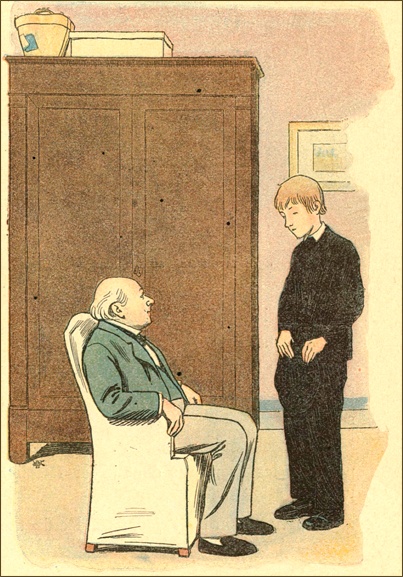
[↔]
«JE VOUS SERVIRAI DE MON MIEUX, MONSIEUR.»
La femme de chambre me déposa dans un coin, puis se retira.
Comme il régnait dans cet endroit une demi-obscurité, je ne distinguai
rien tout d’abord; mais quel ne fut pas mon étonnement quand, du sein
de cette pénombre, une petite voix ténue, cette faible voix des choses
que les hommes ne peuvent percevoir, m’interpella soudain:
«Bonjour, cher parapluie vert! Sois le bienvenu dans ce paisible séjour!
—Qui êtes-vous?
—Devine, devine! je te le donne en cent, je te le donne en mille»,
disait l’organe inconnu avec un ton à la fois joyeux et moqueur.
Je ne devinais pas du tout, mais je m’habituais peu à peu à l’obscurité
et commençais à discerner les objets qui se trouvaient autour de moi;
c’est ainsi que j’aperçus, appuyée contre un vieux bahut, la silhouette
élégante d’une ombrelle.
«Ciel! serait-ce possible? Mais oui, c’est bien elle que je retrouve
encore une fois, ma chère ombrelle bleue!
—Eh bien, tu me reconnais maintenant! Moi, je t’ai reconnu tout de
suite, quoique tu aies un peu vieilli, pour dire vrai; je ne suis plus
jeune, non plus, hélas! Tout le 60 monde me trouve démodée, ce qui,
vois-tu, est la vieillesse anticipée des choses, au siècle où nous
sommes.
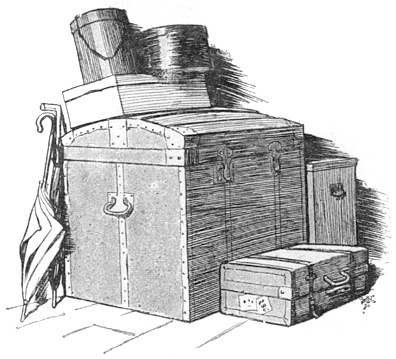
[↔]
«JE FUS PLACÉ AU GRENIER.»
—Mais comment es-tu venue dans cette maison? Quand je t’entrevis à
la fête de famille que M. Fabre donnait à ses ouvriers, tu me dis, je
m’en souviens, que Mlle Rossignol t’avait échangée contre un éventail
appartenant une de ses amies.
—Cette amie, à son tour, m’a donnée à la femme de chambre de Mme
Mancel qui lui avait rendu un petit service; mais, comme c’est une
fille très coquette j’ai bientôt cessé de lui paraître assez élégante,
et elle m’a reléguée dans son grenier; je m’y plais beaucoup, mais
surtout maintenant que j’ai eu le bonheur de te retrouver, je vais
vivre heureuse auprès de toi; jamais les affections d’enfance ne
paraissent plus douces et plus précieuses qu’au déclin de la vie.
—Oui, lui dis-je, abondant dans son sentiment; l’amitié vraie console
de tout, même de l’ingratitude des hommes, dont nous avons eu tous deux
tant à souffrir, n’est-ce pas?»
Comme l’ombrelle bleue, j’aspirais au repos, et, las des épreuves de ma
carrière, je ne demandais plus la pluie et les orages, de même que mon
amie renonçait volontiers au soleil.
Ce fut elle qui me suggéra la pensée d’écrire mes mémoires et de fixer
ainsi pour la postérité les aventures dont je lui faisais le récit. Ma
tâche est terminée, du moins je l’espère.
Pourvu qu’on n’ait jamais l’idée de me faire recouvrir!
FIN
5712-93.—Corbeil., Imprimerie Éd. Crété.
Au lecteur
Cette version numérisée reproduit dans son intégralité la version
originale. Les erreurs manifestes de typographie ont été corrigées.
La ponctuation a pu faire l’objet de quelques corrections mineures.
*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 76540 ***